Un collectif de citoyens bordelais et de personnalités s'intéressant au rôle de l'Etat français dans le génocide des tutsi du Rwanda adresse cette lettre à Alain Juppé, récemment
réélu maire de Bordeaux et ministre des affaires étrangères de 1993 à 1995.
Monsieur Alain Juppé,
Nous, habitants de Bordeaux, et citoyens attentifs au respect de la mémoire des victimes du génocide des Tutsi au Rwanda, constatons que depuis 20 ans vous tenez, concernant ce crime, un
discours qui entre en contradiction avec la réalité des faits. Il suscite de graves interrogations sur votre rôle à l'époque, ainsi que sur celui de notre État, auxquelles nous vous invitons à
répondre.
Vous étiez ministre des affaires étrangères d'avril 1993 à avril 1995. Au cours de cette période, au Rwanda, se mettait en place et se réalisait un génocide : en 1994, il y a 20 ans, plus de
800 000 personnes furent assassinées pour la seule raison que la mention Tutsi figurait sur leurs cartes d'identité. Les forces armées rwandaises (FAR) et les milices civiles réalisèrent les
massacres. Ce crime, organisé et rapide, dura 3 mois !
L’État français, jusqu'en 1994, était particulièrement proche des autorités rwandaises. La présence militaire sur place est un des aspects les plus visibles de cette proximité : de 1990 à la
fin du génocide, 3 opérations françaises se déployèrent au Rwanda, et il n'y eut que quelques mois au cours desquels notre armée ne fut pas présente en nombre sur le territoire de ce petit
pays. Depuis 20 ans, des historiens, des écrivains, des journalistes, des associations, ainsi que des organisations internationales
1, accusent les autorités françaises
d'avoir une responsabilité coupable dans la réalisation du génocide, ou d'avoir été complices de celui-ci.
Environ 10 ans après les faits, des responsables politiques français commencèrent à parler « d'erreur criminelle » (B. Kouchner), puis « d'aveuglement » (N. Sarkozy), pour qualifier les
décisions prises par notre État à cette époque
2. Mais votre position est toute autre. Selon vous, la France n'a rien à se reprocher, bien au contraire. Vos arguments sont clairs, vous les développez par
exemple sur votre blog, dans un article mis en ligne le 1er mars 2010.
Concernant les accusations dirigées contre vous, vous vous contentez de les balayer d'un revers de la main, au seul motif qu'elles ne seraient « évidemment qu'un tissu d'allégations mensongères
». Mais lorsque vous exposez votre vision des événements, force est de constater que vous omettez et contredisez des faits avérés, afin de produire un discours dédouanant les dirigeants
français de toute responsabilité.
Selon vous, M. Juppé, « le gouvernement français a tout fait pour réconcilier le gouvernement du président Habyarimana, légalement élu, et le leader du front patriotique rwandais (FPR) », «
bref le processus de paix semblait bien engagé... jusqu'à l'attentat du 6 avril 1994 qui a évidemment ruiné les efforts de la diplomatie française. ».
Vous offrez, en quelques phrases, un vernis démocratique au régime de Juvénal Habyarimana, arrivé en pouvoir en 1973 par un coup d'état, et vous légitimez ainsi l'aide que lui offraient les
autorités françaises. Mais vous fermez les yeux sur tous les éléments qui montraient la préparation du génocide : le massacre des Bagogwe en 1991 ; celui des Tutsi dans le Bugesera, dans la
région de Kibuye et dans le nord-ouest en 1992 et 1993 ; ainsi que les nombreux rapports, français
3 et internationaux, qui en attestent. Les plus notables, publiés en 1993, sont celui de 4
ONG
4, dont la FIDH,
et celui de la commission des droits de l'Homme de l'ONU 5. Ils interrogent déjà sur la possibilité de qualifier ces massacres de génocide. Ils démontrent également qu'ils sont encadrés par les
autorités administratives et l'armée rwandaise, à une époque où les forces militaires françaises collaborent étroitement avec celles-ci.
Devant la multitude de ces voyants rouges
6, n'aurait-il pas été de votre devoir de dénoncer les crimes du régime et d'appeler à suspendre notre coopération, plutôt que de les camoufler derrière le
paravent des accords d'Arusha ?
Ce processus de paix, bien engagé selon vous, était pourtant qualifié par le président Habyarimana de « chiffon de papier »
7. Pouviez-vous réellement ignorer que
l'État français enfreignait ses clauses, notamment en poursuivant les fournitures d'armes au régime raciste de Kigali bien après sa signature définitive (le 04 août 1993) : la Mission des
Nations unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR) intercepta, sur l'aéroport de la capitale, une livraison en janvier 1994
8; selon Edouard Balladur, la dernière
autorisation d'exportation de matériel de guerre date du 6 avril
9? Enfin, et c'est beaucoup plus grave, Human Rights Watch révèle, après une enquête menée en 1995, qu'au moins 5 livraisons
d'armes en provenance de la France et à destination des forces génocidaires ont eu lieu via l'aéroport de Goma, à la frontière zaïroise
10. Elles s'effectuèrent après le 17
mai, alors que plus personne ne pouvait ignorer qu'un génocide était en cours, et que l’ONU venait de décréter un embargo sur les armes.
Les témoignages qui étayent ces conclusions sont-ils tous, eux aussi, mensongers ? Vous admettiez pourtant, durant le génocide, ne pas connaître les décisions de l’Élysée concernant les ventes
d'armes
11. N'est-ce pas
plutôt ces dernières qui ruinèrent les efforts de la diplomatie française, si ces efforts ont existé ? Et l’État français ne doit-il pas se reprocher cette aide aux génocidaires ?
Par ailleurs, vous écrivez : « loin de se taire sur tout ce qui s'est alors passé au Rwanda, le gouvernement français a, par ma voix, solennellement dénoncé le génocide dont des centaines de
milliers de Tutsis étaient les victimes. ». C'est vrai, vous avez dénoncé le génocide, et vous étiez le premier responsable politique français à le faire, à un moment où il devenait impossible
de nier son existence, et où l’État devait corriger sa position. C'était le 16 mai 1994, cinq semaines après le début des massacres, alors que certains médias français employèrent le mot de
génocide dès le 11 avril
12, et que l'ordre d'opération d'Amaryllis
13, daté du 8 avril, mentionnait que « les membres de la garde présidentielle ont mené [...] l'arrestation et l'élimination des
opposants et des Tutsis ». Les autorités françaises savaient. Elles étaient les mieux placées pour connaître exactement ce qui se passait au Rwanda, bien avant le 16 mai.
Mais quand, devant l'évidence des faits, vous dénoncez les responsables des massacres, c'est pour mieux mentir sur leur chronologie en prétendant, le 18 mai à l'assemblée nationale , qu'ils
sont la conséquence d'une nouvelle attaque du FPR
14. Or le FPR, en 1994, n'est intervenu qu'après le début du génocide
15, et il était la seule force sur place à mettre fin à celui-ci. Présenter les choses comme vous le faisiez,
n'était-ce pas une manière de détourner les accusations qui visaient ses véritables auteurs ?
De plus, le 16 juin, dans une tribune accordée au journal Libération
16, vous parlez des « responsables de ces génocides » au Rwanda, au pluriel, laissant entendre qu'il y aurait eu un second
génocide, commis par une autre partie que vous ne nommez pas. Cette thèse, que plus personne n'ose sérieusement soutenir aujourd'hui, permettait de dédouaner les responsables des tueries, en
prétendant qu'ils ne faisaient que se défendre... Vous repreniez ainsi l'argument qu'employaient les génocidaires pour exterminer la population civile Tutsi. Quels éléments pouvaient être
suffisants pour vous permettre d'évoquer un second génocide, alors que le rapport de l'ONU d’août 1993
17 ne vous avait, lui, pas alerté ? Oseriez-vous encore, M. Juppé, laisser entendre qu'en 1994 plusieurs
génocides étaient commis au Rwanda ?
Nous l'avons vu, les autorités françaises connaissaient la nature et l'ampleur des massacres, dès le commencement de ceux-ci
18. Pouviez-vous ignorer qu'un
génocide était en cours lorsque vous receviez à Paris, le 27 avril, le ministre des affaires étrangères du gouvernement intérimaire rwandais, ainsi que l'idéologue extrémiste Jean-Bosco
Barayagwiza ? Ce dernier est l'un des fondateurs de la RTLM, la radio appelant aux tueries, qui fut un outil fondamental du génocide
19. Il a été condamné à 32 ans de
prison par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda. La réception de ces personnes au Quai d'Orsay, mais aussi à l’Élysée et à Matignon, « rendait le génocide respectable », pour employer
les mots de l'historienne Alison Des Forges
20. La Belgique et les USA leur avaient fermé leurs portes, la France fut le seul pays occidental à traiter avec eux.
Cette réception, M. Juppé, vous la taisez. Vous ne pouvez pas même la justifier par une condamnation verbale des responsabilités portées par vos hôtes. Celle-ci n'a pas existé...
Vous écrivez enfin « Ce que je sais, c'est que la communauté internationale a fait preuve d'une passivité, voire d'un « aveuglement » scandaleux. [...] le conseil de sécurité a été incapable de
prendre la moindre décision... sauf celle de ramener les effectifs de la MINUAR de 2548 à 270 hommes (21 avril 1994) » ; « Devant la carence de la communauté internationale [...], la France a
été la seule à avoir un sursaut de courage. J'ai longuement expliqué, à l'époque, l’initiative qui a abouti à l'opération Turquoise ».
Là encore, vous contredisez les faits. La France ne s'est nullement opposée à la passivité de la communauté internationale que vous dénoncez. Elle y a participé, en votant la résolution 912 du
conseil de sécurité de l'ONU, réduisant l'effectif de la MINUAR à 270 hommes, le 21 avril 1994, 14 jours après le début du génocide. Vous avez vous même déclaré, lors du conseil des ministres
restreint du 13 avril 1994, être favorable à la suspension de la MINUAR
21, à un moment où le pire pouvait encore être évité. Ce n'est que dans un second temps, au mois de juin, alors que le génocide
touche à sa fin, que l’État français prend la décision d'intervenir. Ce n'est pas un moment anodin : Kigali menace de tomber aux mains du FPR, qui s'oppose militairement aux forces armées
rwandaises et stoppe l'extermination des Tutsi.
Faut-il rappeler que l'opération Turquoise, qualifiée d'« humanitaire », était lourdement armée
22 et composée en grande partie de l'élite des forces spéciales
23? Et que la France a imposé
unilatéralement, sans l'accord du conseil de sécurité, une « zone humanitaire sûre » dans laquelle les tueurs ne seront pas désarmés, les responsables ne seront pas arrêtés, et depuis laquelle
la RTLM, qui appelait aux massacres, pourra continuer à émettre sans souffrir de tentative de brouillage ni de neutralisation
24?
Les forces françaises avaient pourtant le devoir d'interrompre le génocide et d'arrêter les coupables, notamment à partir du 28 juin, date de sa reconnaissance par l'ONU : la France est
signataire de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, et l'opération « humanitaire », placée dans le cadre du chapitre VII
25 de la charte de l'ONU, pouvait
recourir à « tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs humanitaires énoncés »
26. Mais les objectifs militaires sur place étaient tout autre, comme en témoignent des propos d'officiers
27, ainsi que l'ordre d'opération de
Turquoise appelant à inciter les autorités locales à rétablir leur autorité
28. Il s'agit bien ici des autorités qui ordonnaient et organisaient le génocide !
Si l'opération Turquoise a permis par endroits de sauver des vies, elle a ailleurs, comme à Bisesero, du 27 au 30 juin, laissé les tueurs finir librement leur besogne
29. Elle a créé un véritable
sanctuaire, défendu militairement, dans lequel les responsables du génocide ne pouvaient être inquiétés, puis elle a organisé leur fuite vers le Zaïre
30.
Continuez-vous à prétendre, M. Juppé, contre l'évidence des faits, que l’État français s'est opposé à la passivité de l'ONU devant le génocide des Tutsi ? Et que l'opération Turquoise n'était
qu'une opération humanitaire, dont le but était de lutter contre ce génocide ?
Aux premiers jours du génocide, les extrémistes hutu se retrouvaient à l'ambassade de France. Les discussions devant aboutir à la formation du gouvernement génocidaire s'y tinrent en partie,
avec la participation de l'ambassadeur J.-M. Marlaud, donc sous votre responsabilité directe
31. Durant la même période, tout près de l'ambassade, Madame Agathe Uwilingiyimana, première ministre dite hutu modérée,
favorable aux accords de paix, se faisait assassiner, comme beaucoup des responsables politiques partageant ses opinions. Vous n'avez jamais eu un mot pour dénoncer ces assassinats ! Mais vous
avez traité, comme nous l'avons vu, avec le gouvernement génocidaire, le reconnaissant de fait et lui offrant la caution de la France.
En 1998, lors de votre audition par la mission d'information parlementaire, vous avez évoqué ces faits par un euphémisme particulièrement surprenant, parlant du « départ des hutus modérés
»
32. Plus qu'une
maladresse, n'était-ce pas là, encore une fois, une manière de dédouaner les criminels avec qui vous traitiez, et de refaire le passé ?
Vingt ans après, alors que notre justice vient pour la première fois de juger, et de déclarer coupable de génocide, un Rwandais séjournant en France, n'est-il pas grandement temps d'oser
regarder le passé en face? Nous souhaitons que l’État qui nous représente ait la dignité de reconnaître ses erreurs. C'est la seule attitude qui puisse nous paraître respectable, aujourd'hui,
devant la souffrance immense générée par le génocide des Tutsi.
Le mandat que vous aviez à l'époque, les décisions que vous avez prises, la manière dont vous les avez défendues jusqu'à présent, font de vous un acteur majeur de la politique française au
Rwanda. Les mensonges de ceux qui nous gouvernaient en 1994, concernant l'aide fournie à la réalisation du génocide des Tutsi, nous concernent au plus haut point. Votre discours, qui entre en
contradiction avec les faits avérés, pourrait être qualifié de révisionniste. Il nous paraît inacceptable qu'un homme tenant des propos sur un génocide visant à tromper ses concitoyens puisse
représenter la population bordelaise. C'est également notre dignité qui est en jeu ! Nous vous invitons donc, encore une fois, à répondre avec clarté et honnêteté aux questions que nous vous
posons.
Signataires :
- AUBRY Patrick (réalisateur, Pessac);
- BOURREAU Pierre (chercheur en informatique, Bordeaux);
- CATTIER Emmanuel (Commission d’Enquête Citoyenne pour la vérité sur l'implication française dans le génocide des Tutsi);
- CLARKE Bruce (plasticien);
- COURTOUX Sharon (membre fondateur de l'association Survie);
- DELTOMBE Thomas (éditeur et journaliste);
- DIA Thierno I. (analyste de l'image, Bordeaux); DIOP Boubacar Boris (écrivain);
- FANON MENDES FRANCE Mireille (membre de la Fondation Frantz Fanon);
- GALABERT Jean-Luc (psychologue);
- GAUTHIER Alain (président du CPCR);
- GODARD Marie Odile (maître de conférences en psychologie, Amiens);
- GOUTEUX Bruno (journaliste et webmaster);
- GRANDCHAMP Simon (ingénieur, Bordeaux);
- GRENIER Etienne (avocat, Bordeaux);
- HANNA Gilbert (syndicaliste et journaliste à la clé des ondes, Bordeaux);
- KAYIMAHE Vénuste (rwandais et rescapé, écrivain, employé au Centre d’échanges culturels franco-rwandais à Kigali de 1975 à 2000);
- LAINÉ Anne (cinéaste, présidente d'Appui Rwanda);
- DE LA PRADELLE Géraud (professeur émérite);
- LE COUR GRANDMAISON Olivier (universitaire);
- LEMOINE Benoît (président de Survie Gironde, Bordeaux);
- MABON Armelle (historienne);
- MESTRE Claire (médecin et anthropologue, Bordeaux);
- MOREL Jacques (auteur de La France au cœur du génocide des Tutsi);
- MUGICA Romain (psychologue, Gradignan);
- MUKANTABANA Adélaïde (Rwandaise et rescapée, Bègles);
- NDIAYE Abdourahmane (économiste, Bordeaux);
- NONORGUES Marie-Paule (avocate, Bordeaux);
- LES OGRES DE BARBACK (artistes);
- OUEDRAOGO Dragoss (anthropologue, cinéaste, réalisateur, Bordeaux);
- PETITDEMANGE Cécile (étudiante à Sciences Po Bordeaux);
- ROBERT Nicolas (infirmier, Bordeaux);
- DE SAINT-EXUPÉRY Patrick (auteur de L'inavouable, la France au Rwanda (Ed. des Arènes, 2004), Complices de l'inavouable, la France au Rwanda (Ed. des Arènes,
2009), La fantaisie des Dieux, Rwanda 94 (Récit graphique en bd, avec Hippolyte, Ed. des Arenes, 2014));
- SITBON Michel (éditeur et journaliste);
- SOW Cheikh (militant d'éducation populaire, Bordeaux);
- TARRIT Fabrice (président de Survie);
- TOBNER Odile (ancienne présidente de Survie);
- TOULABOR Comi (directeur de recherche à Sciences Po Bordeaux);
- TRYO (artistes)
1. Parmis lesquels : Marcel Kabanda, Jean-Pierre Chrétien, Alison Des Forges, Gérard Prunier, Catherine Coquery-Vidrovitch (historiens), Colette Braeckman, Patrick de Saint-Exupéry,
Jean-François Dupaquier, Laure de Vulpian (journalistes), Boubacar Boris Diop, Jacques Morel (écrivains), FIDH, Human Rights Watch, Survie, etc.↩
2. Auparavant les USA, par les voix de B. Clinton et M. Albright, ont reconnu leurs erreurs et présenté des excuses, le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan a exprimé ses regrets, le
Premier ministre belge G. Verhofstadt a déclaré «au nom de mon pays et de mon peuple, je demande pardon ».↩
3. Par exemple l’ambassadeur français à Kigali Georges Martres adresse, le 15 octobre 1990, au Quai d’Orsay un télégramme où il utilise les termes de « génocide » et d’« élimination totale
des Tutsi » : " [la population rwandaise d'origine tutsi] compte encore sur une victoire militaire, grâce à l’appui en hommes et en moyens venus de la diaspora. Cette victoire militaire, même
partielle, lui permettrait, d’échapper au génocide." En 1998, G. Martres déclare à la Mission d'Information Parlementaire : "Le génocide était prévisible dès cette époque [fin 1990]". L'attaché
de défense à Kigali, le colonel R. Galinié, écrit dans un message envoyé à Paris le 24 octobre 1990 l'éventualité de « l'élimination physique à l'intérieur du pays desTutsis, 500 000 à 700 000
personnes, par les Hutus, 7 millions d'individus... »↩
4. Rapport de la Commission internationale d'enquête sur les violations des Droits de l'homme au Rwanda depuis le 1er octobre 1990 ; (7-21 janvier 1993) réalisé par la Fédération
Internationale des Droits de l'Homme (Paris ), Africa Watch (une division de Human Rights Watch, New York ), l'Union Inter-Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, (Ouagadougou ), le
Centre International des Droits de la Personne etdu Développement Démocratique (Montréal). Mars 1993. Dans ses conclusions, la Commission aborde directement la question du génocide : « Les
témoignages prouvent que l’on a tué un grand nombre de personnes pour la seule raison qu’elles étaient Tutsi. La question reste de savoir si la désignation du groupe ethnique “Tutsi” comme
cible à détruire relève d’une véritable intention, au sens de la Convention, de détruire ce groupe ou une part de celui-ci “comme tel. [...] La Commission estime que, quoi qu’il en soit des
qualifications juridiques, la réalité est tragiquement identique : de nombreux Tutsis, pour la seule raison qu’ils appartiennent à ce groupe, sont morts, disparus ou gravement blessés et
mutilés ; ont été privés de leurs biens ; ont dû fuir leur lieu de vie et sont contraints de se cacher ; les survivants vivent dans laterreur. »http://cec.rwanda.free.fr/documents/doc/RapportMars93/ComIntMars93.pdf J. Carbonare, l'un des membres de cette commission déclare le 28 janvier 1993
au journal de 20h de France 2 : « Ce qui nous a beaucoup frappé au Rwanda, c’est à la fois l’ampleur, la systématisation, l’organisation même, de ces massacres. [...] Il y a un mécanisme qui se
met en route [...] On a parlé de purification ethnique, de génocide, de crimes contre l’humanité [...] nous insistons beaucoup sur ces mots ». Vidéo visible ici : http://survie.org/genocide/il-y-a-vingt-ans/article/il-y-a-20-ans-le-genocide-des↩
5. Rapport présenté par M. Waly Bacre Ndiaye, rapporteur spécial, sur la mission qu'il a effectué au Rwanda du 8 au 17 avril 1993. Août 1993. Le Rapporteur Spécial de
l’ONU soulève explicitement la question de savoir si les massacres peuvent être qualifiés de génocide : « Il ressort très clairement des cas de violences intercommunautaires portés à
l’attention du Rapporteur spécial que les victimes des attaques, des Tutsi dans l’écrasante majorité des cas, ont été désignés comme cible uniquement à cause de leur appartenance ethnique, et
pour aucune autre raison objective. On pourrait donc considérer que les alinéas a) et b) de l’article II [qui porte définition du génocide dans la convention de 1948] sont susceptibles de
s’appliquer [...] » http://survie.org/IMG/pdf/rapport-Bacre-Ndiaye-Rwanda-1993.pdf↩
6. Auxquels s'ajoutent : l'article de l'historien J.-P. Chrétien dénonçant en mars 1993 dans la revue Esprit « un dévoiement tragique vers un génocide », le fax du général R. Dallaire
(MINUAR) du 11 janvier 1994, transmis le lendemain à l'ambassade de France, et démontrant la préparation des massacres. ↩
7. Alison Des Forges, Aucun témoin ne doit survivre. Le génocide au Rwanda. Karthala, Human Rights Watch, Fédération internationale des Droits de l’homme, avril 1999. ↩
8. La France a livré des armes dans la nuit du 21 au 22 janvier 1994 : « Un DC-8 français transportant un chargement d’armes comprenant 90 caisses de mortiers de 60 mm, fabriqués en
Belgique mais provenant de France, atterrit en secret dans la nuit. La MINUAR découvrit ce chargement qui violait les termes des accords d’Arusha, et plaça les armes sous la garde conjointe de
la MINUAR et de l’armée rwandaise. » (Alison Des Forges, cf. note 7). La mission d'information parlementaire relève que «le dernier agrément délivré par la CIEEMG [Commission interministérielle
d’étude des exportations de matériel de guerre, à laquelle participe le ministère des affaires étrangères] concernant des ventes de matériels de guerre au Rwanda remonte au 20 janvier 1994 ».
Elle relève également 6 Autorisations d’Exportation de Matériels de Guerre en 1994, dont une de 50 mitrailleuses en date du 22 avril ! Ce sont 6 livraisons d’armes officielles en violation des
accords de paix. ↩
9. Edouard Balladur, L'opération Turquoise : courage et dignité, Le Figaro, 23 août 2004. ↩
10. Rapport HRW, Rwanda/Zaire, Réarmement dans l’impunité. Le soutien international aux perpétrateurs du génocide rwandais, mai 1995 : « Certaines livraisons d’armes à Goma parmi les
premières après le 17 mai étaient des envois du gouvernement français pour les FAR. " et plus loin : " le consul français [en réalité officiellement pro-consul] a signalé d’autres livraisons
d’armes à l’aéroport de Goma pour les FAR de mai à juillet, provenant d’autres sources que le gouvernement français. ([...] Il a ajouté [...] qu’elles pourraient provenir de marchands d’armes
français opérant à titre privé. Les ventes d’armes, même par des sociétés privées, doivent être autorisées par le gouvernement français.) » ↩
11. Le 12 juin 1994, le président et la directrice des opérations de MSF, P. Biberson et B. Vasset, rencontrent A. Juppé et lui demandent : « On dit qu’il y a des livraisons d’armes au
gouvernement rwandais ou au gouvernement intérimaire ou au gouvernement en fuite, est-ce qu’il est exact que la France continue des livraisons d’armes à Goma ? » A. Juppé répond : « Écoutez,
tout ça c’est très confus, il y avait effectivement des accords de coopération ou de défense avec le gouvernement, il y a peut-être eu des reliquats, mais en ce qui concerne mes services, je
peux vous dire que depuis fin mai il n’y a certainement plus aucune livraison d’armes au régime Habyarimana” » Mais en même temps, il dit en regardant de l’autre côté de la Seine, donc vers
l’Élysée : « Mais ce qui peut se passer là-bas, moi je n’en sais rien. » L. Binet, Génocide des Rwandais Tutsis, Médecins sans Frontières, 2003 ↩
12. Le 11 avril 1994 J.-P. Ceppi parle dans Libération du « génocide des Tutsis de Kigali » et M. Mukabamano, journaliste à RFI, déclare au Parisien : « C’est un véritable génocide » ; le
19 avril Human Rights Watch informe le président du Conseil de sécurité que les massacres en cours au Rwanda constituent « un génocide » ; le 24 avril L’ONG Oxfam parle de « génocide »,
etc. ↩
13. Lors de l’opération Amaryllis du 9 au 14 avril, 1 464 militaires français du 1er, 3e, 8e RPIMa et du COS, évacuent exclusivement les ressortissants européens et des extrémistes Hutus.
Les militaires ont reçu l’ordre de ne pas réagir aux massacres. L'historien Gérard Prunier écrit : « quelques Tutsi réussissent à embarquer à bord de camions en route pour l’aéroport : ils
doivent descendre des véhicules au premier barrage de la milice et ils sont massacrés sous les yeux de soldats français ou belges qui, conformément aux ordres, ne réagissent pas. ». Le rapport
de la Mission d’information parlementaire française de 1998 conclus : « Il semble donc [...] que le traitement accordé à l’entourage de la famille Habyarimana ait été beaucoup plus favorable
que celui réservé aux employés tutsis dans les postes de la représentation française – ambassade, centre culturel, Mission de coopération » ↩
14. « Face à l'offensive du front patriotique rwandais, les troupes gouvernementales rwandaises se sont livrées à l'élimination systématique de la population tutsie, ce qui a entraîné la
généralisation des massacres. ». SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 (4e SÉANCE) COMPTE RENDU INTÉGRAL , 2° séance du mercredi 18 mai 1994 . JO de la République Française, débats
parlementaires, assemblée nationale, 19 mai 1994. ↩
15. Audition du Colonel Balis (MINUAR) : « Le 7 avril, vers 9 h 30 m et 11 h 30 m, j’ai pu convaincre le FPR de rester dans son cantonnement, mais une colonne du FPR est malgré tout sortie
vers 16 h 30 m. Ils ont alors créé une zone de sécurité. » Sénat de Belgique - commission des affaires étrangères : Commission d’enquête parlementaire concernant les événements du Rwanda
1-611/(7-15) 1997/1998. Sénat belge, 6 décembre 1997. ↩
16. A. Juppé, « Point de vue » Intervenir au Rwanda, Libération, 16 juin 1994 : « La France n’aura aucune complaisance à l’égard des assassins ou de leurs commanditaires. La France, seul
pays occidental représenté au niveau ministériel à la session extraordinaire de la Commission des droits de l’homme à Genève, exige que les responsables de ces génocides soient jugés
». ↩
17. Voir note 5. ↩
18. Voir notes 6 et 13.↩
19. On pouvait y entendre, entre autres appels aux massacres : « bonjour, je suis un petit garçon de huit ans. est-ce que je suis assez grand pour tuer un tutsi ? Réponse de l'animateur :
comme c'est mignon ! Tout le monde peut le faire, tu sais. » J.-P. Chrétien, Rwanda, les médias du génocide. Ed. Karthala, 2002. ↩
20. Voir note 7.↩
21. A. Juppé : « Aux Nations-Unies, le Secrétaire général doit rendre demain son rapport. Trois solutions sont envisageables : le maintien de la MINUAR, sa suspension avec le maintien
éventuel d’un contingent symbolique ou un retrait total. Les Belges sont favorables à une suspension et c’est aussi mon avis. » Conseil restreint du 13 avril 1994. Document disponible ici
: http://www.francerwandagenocide.org/documents/ConseilRestreint13avril1994.pdf ↩
22. Figurent sur la liste officielle déclarée à l'ONU : 8 avions Mirage, 12 automitrailleuses, 6 mortiers lourds. Auxquels s'ajoutent des avions Mirage IV-P, des hélicoptères de combat
Gazelle , etc. G. Prunier, conseiller au ministère de la Défense en 1994, écrit : « la puissance de feu prévue par les forces françaises semble disproportionnée pour une mission humanitaire »,
Rwanda : le génocide. Dagorno, 1997. ↩
23. Turquoise est composée notamment d'officiers et soldats : du Commandement des Opérations Spéciales (qui réunit des spécialistes de l’action et du renseignement sous l’autorité directe
du chef d’état-major des armées), du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine (forces spéciales), du GIGN et de L’EPIGN (Escadron parachutiste de la gendarmerie nationale) , du 3e
Régiment d’infanterie et de chars de marine (RICM) , du 11e Régiment d’artillerie de marine), de la Légion étrangère , du 2e Régiment étranger d’infanterie, du commando de marine , de
spécialistes des opérations en « zone hostile » du 13e Régiment de Dragons Parachutistes. ↩
24. La résolution 925 du 8 juin du Conseil de sécurité exige : « que toutes les parties mettent fin immédiatement à toute incitation à la violence ou à la haine ethnique, en particulier
par le biais des moyens d’information ». On peut lire le 28 juin dans le rapport de la Commission des Droits de l’homme de l’ONU que «l’intention claire et non équivoque» de commettre le
génocide «se trouve bien contenue dans les appels incessants au meurtre lancés par les médias, en particulier la RTLM». Le 1er Juillet, le représentant de la France à l'ONU parle de faire
cesser ces émissions : « Je voudrais insister avant de conclure sur la responsabilité particulière des médias qui incitent à la haine ethnique et à la violence. La France demande instamment aux
responsables des radios concernées, et en premier lieu à la Radio Mille Collines, de mettre fin à cette propagande criminelle. La France fera tout son possible pour obtenir la cessation de ces
émissions. » Mais selon le général R. Dallaire, la RTLM émet encore le 1er août en direction des camps. ↩
25. Il est important de noter que le 20 juin le représentant de la France à l'ONU fait la demande explicite d'une intervention sous chapitre VII autorisant, contrairement à la MINUAR,
l'usage de la force : « nos gouvernements souhaitent disposer, comme cadre juridique de leur intervention, d’une résolution placée sous le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ». Lettre
datée du 20 juin 1994, adressée au secrétaire général par le représentant permanent de la France auprès de l’organisation des nations unies. http://www.francerwandagenocide.org/documents/S1994-734.pdf ↩
26. ONU, S/RES/929 (1994). http://www.francerwandagenocide.org/documents/94s929.pdf On peut lire également dans l'ordre d'opérations de Turquoise (voir note 28) « mettre fin
aux massacres partout où cela sera possible, éventuellement en utilisant la force » ; « tout en étant en mesure d'intervenir à tout moment, éventuellement par la force, au profit de la
population menacée » ; « marquer si nécessaire par l'usage de la force la volonté française de faire cesser les massacres et de protéger les populations » ; « la légitime défense élargie
comporte l'emploi de la force dans les situations suivantes : - menaces sur nos forces, - menaces dans la mission de protection des personnes, soit contre nos forces, soit contre les
populations protégées, - obstruction dans l'exécution de la mission de nos forces » ↩
27. L'adjudant-chef du GIGN T. Prungnaud explique que « la mission, au départ, c’était d’intervenir sur des massacres soi-disant de Hutu qui seraient massacrés par des Tutsi » (voir note
29) ; le colonel D. Tauzin déclare dans The Guardian du 01 juillet 1994 : « Nous ne sommes pas en guerre avec le gouvernement du Rwanda ou ses forces armées. Ce sont des organisations
légitimes.» ; Le général R. Dallaire (MINUAR) déjeune le 30 juin avec des officiers français et rapporte ce qu’il a entendu : « Ils refusaient d’accepter l’existence d’un génocide et le fait
que les dirigeants extrémistes, les responsables et certains de leurs anciens collègues fassent partie d’une même clique. Ils ne cachaient pas leur désir de combattre le FPR » R. Dallaire, J’ai
serré la main du diable - La faillite de l’humanité au Rwanda. Libre expression, 2003. ↩
28. « Affirmer auprès des autorités locales rwandaises, civiles et militaires, notre neutralité et notre détermination à faire cesser les massacres sur l'ensemble de la zone contrôlée par
les forces armées rwandaises en les incitant à rétablir leur autorité ». On peut y lire également que « plusieurs centaines de milliers de personnes d'ethnies hutue et tutsie ont été
exterminées ». Ordre d'opérations de Turquoise, 22 juin 1994. Document consultable à l'adresse : http://jacques.morel67.pagesperso-orange.fr/a/turquoise-ordreop.pdf↩
29. P. de Saint-Exupéry, L’inavouable - La France au Rwanda. Les Arènes, 2004. L. de Vulpian et T. Prungnaud, Silence Turquoise. Don Quichotte, 2012. ↩
30. Le mensuel de la Légion étrangère, Képi Blanc, d’octobre 1994 confirme que : « Battue sur le terrain, l’armée ruandaise se replie, en désordre, vers la « zone humanitaire sûre ».
L’E.M.T. [l’état-major tactique de l’opération Turquoise] provoque et organise l’évacuation du gouvernement de transition rwandais vers le Zaïre. Le 17 juillet, le gouvernement ruandais passe
au Zaïre. ». ↩
31. Auditions de l'ambassadeur Jean-Michel Marlaud par la Mission d'Information Parlementaire, Enquête sur la tragédie rwandaise 1990-1994 [140, Tome III, Auditions, Vol. 1, pp.
296-297]. ↩
32. Auditions d'Alain Juppé par la Mission d'Information Parlementaire, 21 avril 1998, Enquête sur la tragédie rwandaise 1990-1994 [140, Tome III, Auditions, vol. 1, p.91]. ↩
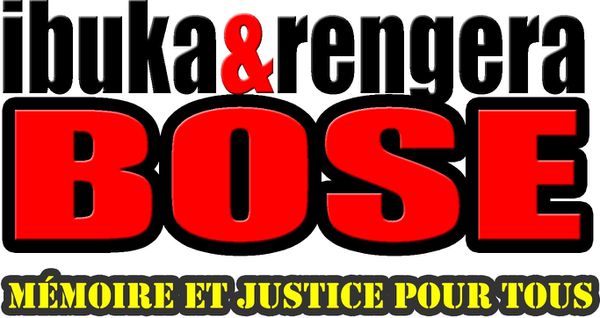
 Le pire péché des médias : la désinformation
Le pire péché des médias : la désinformation
 La ministre de la justice, Christiane Taubira, le 17 novembre 2013. | AFP/ALAIN JOCARD
La ministre de la justice, Christiane Taubira, le 17 novembre 2013. | AFP/ALAIN JOCARD

 Bernard
Lugan
Bernard
Lugan








 NDAGIJIMANA est juriste de
formation. Il a fait ses études dans les universités de Bujumbura et de Kinshasa. Diplomate de carrière, il a servi dans les postes de Bruxelles, Addis Abeba et Paris. C’est un observateur
privilégié des conflits ethniques et politiques de son pays d’origine, le Rwanda, et de toute la région des Grands Lacs. Il anime aujourd’hui plusieurs organisations qui militent en faveur du
respect des droits de l'homme et la réconciliation nationale/régionale basée sur une justice impartiale et le dialogue. Il est
NDAGIJIMANA est juriste de
formation. Il a fait ses études dans les universités de Bujumbura et de Kinshasa. Diplomate de carrière, il a servi dans les postes de Bruxelles, Addis Abeba et Paris. C’est un observateur
privilégié des conflits ethniques et politiques de son pays d’origine, le Rwanda, et de toute la région des Grands Lacs. Il anime aujourd’hui plusieurs organisations qui militent en faveur du
respect des droits de l'homme et la réconciliation nationale/régionale basée sur une justice impartiale et le dialogue. Il est  Je connais trop les exigences de la « realpolitik » pour ne pas
comprendre la prudence de la ligne diplomatique que suit la France depuis plusieurs années dans sa relation avec le Rwanda. Ce pays joue un rôle économique et politique important dans la région
des Grands Lacs et en Afrique en général. Nous avons eu raison de choisir la voie de la réconciliation avec ses dirigeants.
Je connais trop les exigences de la « realpolitik » pour ne pas
comprendre la prudence de la ligne diplomatique que suit la France depuis plusieurs années dans sa relation avec le Rwanda. Ce pays joue un rôle économique et politique important dans la région
des Grands Lacs et en Afrique en général. Nous avons eu raison de choisir la voie de la réconciliation avec ses dirigeants.





 A former ally of Rwandan President Paul Kagame has accused him of complicity in the death of a former
president which sparked the 1994 genocide.
A former ally of Rwandan President Paul Kagame has accused him of complicity in the death of a former
president which sparked the 1994 genocide. L'ancien Premier ministre
L'ancien Premier ministre