

Télécharger le fichier pdf ci-après pour accéder au fichier
L'annonce n'est pas une surprise, mais le calendrier bouscule le jeu: Alain Juppé a officialisé mercredi sa candidature à la primaire présidentielle de son camp, grillant la politesse à Nicolas Sarkozy qui vise lui aussi 2017.
Mais alors que l'ex-chef de l'Etat veut faire de la présidence de l'UMP, soumise au vote des militants le 29 novembre, un tremplin vers l'Elysée, l'ancien Premier ministre et maire de Bordeaux saute cette case.
C'est sur son blog que, prônant le rassemblement, M. Juppé annonce sa candidature à la primaire, en concurrence désormais avec François Fillon, Xavier Bertrand et Christian Estrosi, tous déclarés, le dernier attendant cependant la parole sarkozyste. Nathalie Kosciusko-Morizet devrait également être en lice.
"On aura compris que j'ai envie de participer à cette belle construction", dit l'ex-Premier ministre dans son billet intitulé "2017, bientôt...", après un exposé de ses réflexions sur l'état de la France. "C'est pourquoi j'ai décidé d’être candidat, le moment venu, aux primaires de l'avenir".
Selon celui qui connut en 2004 l'enfer d'une condamnation en justice et de l'inéligibilité, "le bon sens voudrait qu'elles aient lieu au printemps 2016".
Cette candidature n'est pas une surprise: M. Juppé - en vacances outre-Atlantique - s'est exprimé à plusieurs reprises ces derniers mois sur cette éventualité. "Les Français ont l'impression que je peux apporter une vision d’expérience et de sagesse", déclarait-il en novembre 2013.
Contrairement à M. Sarkozy qui a longtemps considéré que la primaire n'était pas faite pour la droite, M. Juppé, impressionné par celle des socialistes en 2011, défend ardemment cette consultation pré-présidentielle, d'ailleurs inscrite "dans les statuts de l'UMP". Elle offre à ses yeux l'avantage de pouvoir le remettre dans le jeu.
Honni par une majorité de Français pour ses réformes à marche forcée du temps où il était à Matignon (1995-1997), il fait désormais figure de "sage". Mieux, il surpasse désormais l'ancien président dans le cœur des Français de droite: 74% ont une "image positive" de lui, contre 69% à M. Sarkozy, selon un sondage CSA du 7 août.
Réélu dès le premier tour maire de Bordeaux en mars, il voit aussi dans des "primaires largement ouvertes" "la méthode qui s'impose" pour "une candidature d'union".
Une victoire en 2017 a pour "première condition" de "rassembler dès le premier tour les forces de la droite et du centre autour d’un candidat capable d’affronter le Front National, d’un côté, et le PS ou ce qui en tiendra lieu, de l’autre".
- "Champ de mines" -
"Si nous nous divisons, l’issue du premier tour devient incertaine et les conséquences sur le deuxième tour imprévisibles", ajoute-t-il, dans une claire mise en garde contre un 21-avril à l'envers, qui verrait s'affronter PS et Front national. "L'UMP doit tendre la main à ses partenaires naturels et créer le climat de confiance nécessaire", dit l'ami de François Bayrou. Le président du MoDem voit en lui "un atout" pour la France
Le jour-même où l'exécutif fait sa rentrée en annonçant des mesures économiques, sociales et fiscales, Alain Juppé avance ses pistes pour sortir de la "morosité ambiante".
Croissance notamment "grâce au retour de la confiance des acteurs économiques" et à "l'innovation", "programme concret d'allègement du fardeau fiscal", "pérennité" du modèle social français "en évitant les dérives et les abus"...: "Ce n’est qu’une modeste contribution à l’élaboration du projet qui demain peut et doit redonner confiance aux Français", écrit-il.
Alain Juppé sort du bois alors que tous dans son parti semblaient suspendus à une entrée en piste - fin août ? Début septembre ? - de Nicolas Sarkozy qui n'a cessé d'envoyer des "cartes postales" pour se rappeler au bon souvenir des Français.
Le fils préféré de Jacques Chirac - "le meilleur d'entre nous", avait-il dit - trouvera face à lui des adversaires déterminés à gagner la pré-candidature - le PS a ironisé sur "un trop-plein" - et notamment François Fillon.
Toutefois, avait dit naguère l'unique Premier ministre de Nicolas Sarkozy, avec Juppé, "il n'y aura pas de coups bas. Avec les autres, c'est un champ de mines où tous les coups sont permis". Mercredi Fillon a évoqué "la garantie d'une confrontation de qualité".
© 2014 AFP
Autre article : Primaire UMP pour 2017 : Juppé prend les devants
-CRÉÉ : 20-08-2014 08:27

Alain Juppé sort du bois. Le maire de Bordeaux annonce mercredi qu’il briguera les suffrages des sympathisants UMP pour porter les couleurs du parti à la présidentielle de 2017. "J’ai décidé d’être candidat, le moment venu, aux primaires de l’avenir", annonce sur son blog celui qui dirige provisoirement l'UMP, depuis le mois de juin, avec François Fillon et Jean-Pierre Raffarin. La conclusion d'un long billet dans lequel il cultive son image de "vieux sage" en exposant ses réflexions et inquiétudes sur l'état de la France. Sans oublier de tacler le gouvernement qui a "perdu la confiance des Français", ni d'appeler à insuffler "un nouvel élan" à l'UMP.
Un sérieux adversaire
Si cette candidature aux primaires qui devraient se tenir en 2016 était dans l'air, on ne l'attendait pas si tôt. En démarrant ainsi la rentrée sur les chapeaux de roue, Alain Juppé rejoint une liste déjà bien fournie de postulants : François Fillon concourra "quoi qu'il arrive", Xavier Bertrand veut y aller "quelles que soient les circonstances", Nathalie Kosciusko-Morizet "ne l'exclut pas", Christian Estrosi est "prêt à aller jusqu'au bout, sauf" en cas de retour de Nicolas Sarkozy... L'ex-chef de l'Etat pourrait dévoiler ses ambitions dans les jours à venir.
Pour tous ces aspirants à l'Elysée, la décision d'Alain Juppé est une mauvaise nouvelle. L'ancien Premier ministre, s'il doit se préparer aux attaques sur son âge – il vient de fêter ses 69 ans le 15 août -, dispose de sérieux atouts pour prendre le dessus sur ses adversaires. Fort de son expérience, et sa condamnation dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris loin derrière lui, le fondateur de l'UMP est régulièrement proclamé "personnalité politique préférée" des Français dans les enquêtes d'opinion. S'il devait être opposé à Nicolas Sarkozy, le duel s'annonce serré.Les sondages donnent les deux hommes au coude-à-coude chez les sympathisants UMP.
A'Salfo, Salif Traore dans le civil (d), leader vocal du groupe Magic System et la chanteuse Dobet Gnahore, le 5 août 2014 à Abidjan
"Nous sommes devenus des messagers !", clame A'Salfo, leader du Magic System, le groupe star de la scène musicale ivoirienne, qui après 17 ans de carrière s'est trouvé une nouvelle ambition: "réconcilier" les Ivoiriens.
Formé en 1997 par quatre garçons issus des quartiers populaires de la capitale économique ivoirienne, Magic System a connu la consécration deux ans plus tard avec son tube "Premier gaou", exporté dans toute la francophonie.
Le groupe a depuis lors collectionné quinze disques d'or, trois de platine, et joué dans des salles aussi mythiques que l'Apollo à New York et l'Olympia à Paris, où ils doivent retourner en septembre.
Avec "Africainement vôtre", leur septième et dernier album, présenté mi-juin à Abidjan, les artistes ont décidé de mettre leur notoriété au service d'une Côte d'Ivoire qui "sort", selon eux, de "sa convalescence" après une décennie de crise.
Le pays a été coupé en deux de 2002 à 2011 entre un Nord tenu par une rébellion favorable à l'actuel président Alassane Ouattara et un Sud loyal à l'ex-chef d'Etat Laurent Gbagbo.
La crise postélectorale, liée au refus de M. Gbagbo de reconnaître la victoire de son adversaire à la présidentielle de novembre 2010, fit plus de 3.000 morts en cinq mois.
L'opus de 14 titres, qui se veut "thérapeutique", "arrive pour soigner les maux du pays car le mot réconciliation est devenu diviseur en Côte d'Ivoire", explique A'Salfo, Salif Traoré dans le civil, à l'AFP.
La campagne de promotion du groupe servira de plaidoyer permanent en faveur de la réconciliation, poursuit-il.
Le chanteur n'en est pas à son premier essai. Dès juillet 2011, trois mois à peine après la chute de Laurent Gbagbo, il lance une campagne pour le retour d'artistes exilés proches de l'ex-président, aujourd'hui détenu par la Cour pénale internationale, devant laquelle il est poursuivi pour "crimes contre l'humanité".
Fin mars, Magic system décide de dédier une partie des concerts du Femua (Festival des musiques urbaines d'Anoumabo), un événement qu'il a créé à Yopougon, un quartier pro-Gbagbo d'Abidjan, au thème: "Paix et cohésion sociale".
- La musique pour la paix -
"C'est une mission noble", salue Angelo Kabila, un promoteur de spectacle lui-même rentré d'exil.
La musique a "besoin de prospérer dans un environnement de paix", souligne cet organisateur du Festival de la musique Zouglou, la bande-son de la jeunesse ivoirienne depuis 20 ans, dont Magic system est le groupe phare.
La Commission justice, vérité et réconciliation (CDVR), "séduite" par ces actions, souhaite que Magic system l'"aide pour une grande mobilisation aux séances d'écoutes", selon Sran Kouassi, l'un de ses responsables.
Environ 16.000 personnes avaient participé fin mai aux audiences de la CDVR, qui s'inspire du modèle sud-africain de justice transitionnelle, sur la base d'audition des bourreaux par leurs victimes, pour encourager le pardon.
Les "Gaous", l'autre nom des Magic system, qui signifie "homme crédule" en nouchi, la langue de la rue, prévoient aussi un "grand concert" le 30 novembre à Abidjan, dont le mot d'ordre sera la défiance envers les politiciens ivoiriens, accusés d'être les "grands déstabilisateurs communs".
Le spectacle est pensé par le groupe comme une grande séance de catharsis, durant laquelle des Ivoiriens de tous bords se retrouveront.
Dans la villa huppée d'A'Salfo à Abidjan, où trônent les trophées glanés ici et là, une photo dans le salon capte l'attention du visiteur : les quatre garçons se trouvent à l’Élysée, aux côtés de l'ex-président français Jacques Chirac et de son épouse Bernadette.
Nommé en septembre 2012 "ambassadeur de bonne volonté" de l'Unesco, A'Salfo, également proche du président ivoirien Alassane Ouattara, veut s'appuyer sur son large carnet d'adresses pour atteindre son objectif.
"Ce n'est pas un rêve... J'y crois dur comme fer à la réconciliation", lance ce père de quatre enfants, âgé de 35 ans.
Une mission périlleuse, rétorquent ses détracteurs. "Tu ne peux être la voix du peuple et en même temps être proche d'un chef de l'Etat", déplore l'un d'eux, ajoutant : "un artiste ne chante pas pour le pouvoir !"
© 2014 AFP
Mon plaidoyer pour le peuple d'Israël: Libérez-vous en libérant la Palestine
Les dernières semaines, des membres de la société civile du monde entier ont lancé des actions sans précédent contre les ripostes brutales et disproportionnées d'Israël au lancement de roquettes depuis la Palestine.
Si l'on fait la somme de tous les participants aux rassemblements du week-end dernier exigeant justice en Israël et en Paslestine - à Cape Town, Washington, New-York, New Delhi, Londres, Dublin et Sydney, et dans toutes les autres villes - cela représente sans aucun doute le plus important tollé de l'opinion citoyenne jamais vu dans l'histoire de l'humanité autour d'une seule cause.
Il y a un quart de siècle, j'ai participé à des manifestations contre l'apartheid qui avaient rassemblé beaucoup de monde. Je n'aurais jamais imaginé que nous assisterions de nouveau à des manifestations d'une telle ampleur, mais celle de samedi dernier à Cape Town fut au moins aussi importante. Les manifestants incluaient des gens jeunes et agés, musulmans, chrétiens, juifs, hindous, bouddhistes, agnostiques, athéistes, noirs, blancs, rouges et verts... C'est ce à quoi on pourrait s'attendre de la part d'une nation vibrante, tolérante et muticulturelle.
J'ai demandé à la foule de chanter avec moi : "Nous sommes opposés à l'injustice de l'occupation illégale de la Palestine. Nous sommes opposés aux assassinats à Gaza. Nous sommes opposés aux humiliations infligées aux Palestiniens aux points de contrôle et aux barrages routiers. Nous sommes opposés aux violences perpétrées par toutes les parties. Mais nous ne sommes pas opposés aux Juifs."
Plus tôt dans la semaine, j'ai appelé à suspendre la participation d'Israël à l'Union Internationale des Architectes qui se tenait en Afrique du Sud.
J'ai appelé les soeurs et frères israéliens présents à la conférence à se dissocier activement, ainsi que leur profession, de la conception et de la construction d'infrastructures visant à perpétuer l'injustice, notamment à travers le mur de séparation, les terminaux de sécurité, les points de contrôle et la construction de colonies construites en territoire palestinien occupé.
"Je vous implore de ramener ce message chez vous : s'il vous plaît, inversez le cours de la violence et de la haine en vous joignant au mouvement non violent pour la justice pour tous les habitants de la région", leur ai-je dit.
Au cours des dernières semaines, plus de 1,7 million de personnes à travers le monde ont adhéré au mouvement en rejoignant une campagne d'Avaaz demandant aux compagnies tirant profit de l'occupation israélienne et/ou impliquées dans les mauvais traitements et la répression des Palestiniens de se retirer. La campagne vise spécifiquement le fonds de pension des Pays-Bas ABP, la Barclays Bank, le fournisseur de systèmes de sécurité G4S, les activités de transport de la firme française Véolia, la compagnie d'ordinateurs Hewlett-Packard et le fournisseur de bulldozers Caterpillar.
Le mois dernier, 17 gouvernements européens ont appelé leurs citoyens à ne plus entretenir de relations commerciales ni investir dans les colonies israéliennes illégales.
Récemment, on a pu voir le fond de pension néerlandais PGGM retirer des dizaines de millions d'euros des banques israéliennes, la fondation Bill et Melinda Gates désinvestir de G4S, et l'église presbytérienne américaine se défaire d'un investissement d'environ 21 millions de dollars dans les entreprises HP, Motorola Solutions et Caterpillar.
C'est un mouvement qui prend de l'ampleur.
La violence engendre la violence et la haine, qui à son tour ne fait qu'engendrer plus de violence et de haine.
Nous, Sud-Africains, connaissons la violence et la haine. Nous savons ce que cela signifie d'être les oubliés du monde, quand personne ne veut comprendre ou même écouter ce que nous exprimons. Cela fait partie de nos racines et de notre vécu.
Mais nous savons aussi ce que le dialogue entre nos dirigeants a permis, quand des organisations qu'on accusait de "terroristes" furent à nouveau autorisées, et que leurs meneurs, parmi lesquels Nelson Mandela, furent libérés de prison ou de l'exil.
Nous savons que lorsque nos dirigeants ont commencé à se parler, la logique de violence qui avait brisé notre société s'est dissipée pour ensuite disparaître. Les actes terroristes qui se produisirent après le début ces échanges - comme des attaques sur une église et un bar - furent condamnés par tous, et ceux qui en étaient à l'origine ne trouvèrent plus aucun soutien lorsque les urnes parlèrent.
L'euphorie qui suivit ce premier vote commun ne fut pas confinée aux seuls Sud-Africains de couleur noire. Notre solution pacifique était merveilleuse parce qu'elle nous incluait tous. Et lorsqu'ensuite, nous avons produit une constitution si tolérante, charitable et ouverte que Dieu en aurait été fier, nous nous sommes tous sentis libérés.
Bien sûr, le fait d'avoir eu des dirigeants extraordinaires nous a aidés.
Mais ce qui au final a poussé ces dirigeants à se réunir autour de la table des négociations a été la panoplie de moyens efficaces et non-violents qui avaient été mis en oeuvre pour isoler l'Afrique du Sud sur les plans économique, académique, culturel et psychologique.
A un moment charnière, le gouvernement de l'époque avait fini par réaliser que préserver l'apartheid coûtait plus qu'il ne rapportait.
L'embargo sur le commerce infligé dans les années 80 à l'Afrique du Sud par des multinationales engagées fut un facteur clé de la chute, sans effusion de sang, du régime d'apartheid. Ces entreprises avaient compris qu'en soutenant l'économie sud-africaine, elles contribuaient au maintien d'un statu quo injuste.
Ceux qui continuent de faire affaire avec Israël, et qui contribuent ainsi à nourrir un sentiment de « normalité » à la société israélienne, rendent un mauvais service aux peuples d'Israël et de la Palestine. Ils contribuent au maintien d'un statu quo profondément injuste.
Ceux qui contribuent à l'isolement temporaire d'Israël disent que les Israéliens et les Palestiniens ont tous autant droit à la dignité et à la paix.
A terme, les évènements qui se sont déroulés à Gaza ce dernier mois sont un test pour ceux qui croient en la valeur humaine.
Il devient de plus en plus clair que les politiciens et les diplomates sont incapables de trouver des réponses, et que la responsabilité de négocier une solution durable à la crise en Terre Sainte repose sur la société civile et sur les peuples d'Israël et de Palestine eux-mêmes.
Outre la dévastation récente de Gaza, des personnes honnêtes venant du monde entier - notamment en Israël - sont profondément perturbées par les violations quotidiennes de la dignité humaine et de la liberté de mouvements auxquelles les Palestiniens sont soumis aux postes de contrôle et aux barrages routiers. De plus, les politiques israëliennes d'occupation illégale et la construction d'implantations en zones tampons sur le territoire occupé aggravent la difficulté de parvenir à un accord qui soit acceptable pour tous dans le futur.
L'Etat d'Israël agit comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ses habitants ne connaîtront pas l'existence calme et sécuritaire à laquelle ils aspirent, et à laquelle ils ont droit, tant que leurs dirigeants perpétueront les conditions qui font perdurer le conflit.
J'ai condamné ceux qui en Palestine sont responsables de tirs de missiles et de roquettes sur Israël. Ils attisent les flammes de la haine. Je suis opposé à toute forme de violence.
Mais soyons clairs, le peuple de Palestine a tous les droits de lutter pour sa dignité et sa liberté. Cette lutte est soutenue par beaucoup de gens dans le monde entier.
Nul problème créé par l'homme n'est sans issue lorsque les humains mettent en commun leurs efforts sincères pour le résoudre. Aucune paix n'est impossible lorsque les gens sont déterminés à l'atteindre.
La paix nécessite que le peuple d'Israël et le peuple de Palestine reconnaissent l'être humain qui est en eux et se reconnaissent les uns les autres afin de comprendre leur interdépendance.
Les missiles, les bombes et les invectives brutales ne sont pas la solution. Il n'y a pas de solution militaire.
La solution viendra plus probablement des outils non violents que nous avons développés en Afrique du Sud dans les années 80 afin de persuader le gouvernement sud africain de la nécessité de changer sa politique.
La raison pour laquelle ces outils - boycott, sanctions et retraits des investissements - se sont finalement avérés efficaces, est qu'ils bénéficiaient d'une masse critique de soutien, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le même type de soutien envers la Palestine dont nous avons été témoins de par le monde durant ces dernières semaines.
Mon plaidoyer envers le peuple d'Israël est de voir au-delà du moment, de voir au-delà de la colère d'être perpétuellement assiégé, de concevoir un monde dans lequel Israël et la Palestine coexistent - un monde dans lequel règnent la dignité et le respect mutuels.
Cela demande un changement de paradigme. Un changement qui reconnaisse qu'une tentative de maintenir le statu-quo revient à condamner les générations suivantes à la violence et l'insécuruté. Un changement qui arrête de considérer une critique légitime de la politique de l'Etat comme une attaque contre le judaisme. Un changement qui commence à l'intérieur et se propage à travers les communautés, les nations et les régions- à la diaspora qui s'étend à travers le monde que nous partageons. Le seul monde que nous partageons !
Quand les gens s'unissent pour accomplir une cause juste, ils sont invincibles. Dieu n'interfère pas dans les affaires humaines, dans l'espoir que la résolution de nos différends nous fera grandir et apprendre par nous-mêmes. Mais Dieu ne dort pas. Les textes sacrés juifs nous disent que Dieu est du côté du faible, du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger qui a permis à des esclaves d'entamer leur exode vers une Terre Promise. C'est le prophète Amos qui a dit que nous devrions laisser la justice couler telle une rivière.
À la fin, le bien triomphera. Chercher à libérer le peuple de Palestine des humiliations et des persécutions que lui inflige la politique d'Israël est une cause noble et juste. C'est une cause que le peuple d'Israël se doit de soutenir.
Nelson Mandela a dit que les Sud Africains ne se sentiraient pas complètement libres tant que les Palestiniens ne seraient pas libres.
Il aurait pu ajouter que la libération de la Palestine serait également la libération d'Israël.
Arusha, 21 août 2014 (FH) - Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) qui doit fermer ses portes à la fin de l'année organisera un colloque international sur son héritage les 6 et 7 novembre prochains, à son siège à Arusha, dans le nord de la Tanzanie.
« Le colloque a pour ambition de donner l'occasion aux experts de réfléchir sur la contribution du TPIR au développement du droit international humanitaire, l'administration de la justice et la promotion de la primauté du droit, en particulier dans la région des Grands lacs », indique le tribunal dans un communiqué publié sur son site internet.
Le TPIR invite les experts dans le domaine de la justice internationale à soumettre des propositions qui seront présentées lors du colloque.
Créé par une résolution du Conseil de sécurité de novembre 1994, le TPIR a mis en accusation 93 personnes, dont 61 ont été condamnées pour leur rôle dans le génocide des Tutsis. Parmi ces personnes, figurent d'anciens ministres, des officiers supérieurs de l'ancienne armée, de grands hommes d'affaires et des hommes d'église.
Neuf accusés sont encore en fuite.
ER
© Agence Hirondelle
Un régime qui a peur
Lors d'un déplacement dans l'ouest du pays, début juin 2014, le président Paul Kagamé a expliqué aux habitants du district de Nyabihu : « Nous ne pouvons laisser personne compromettre notre sécurité et notre développement. Ceux qui chercheront à déstabiliser le pays continueront à être arrêtés. on pourrait même être amené à les tuer en plein jour ». Le pouvoir en place à Kigali est persuadé que le pays est en proie à une menace sécuritaire imminente venant de République Démocratique du Congo (RDC) : des infiltrations d’éléments des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) - groupe armé rwandais basé en RDC - seraient en cours.
Une vague de répression
Pour le Rwanda, tous les moyens semblent être bons pour pallier cette menace. Ces dernières années, plusieurs personnes accusées de vouloir attenter à la sûreté de l’État ont été assassinées à l’étranger. D’autres ont été kidnappées dans les pays avoisinants, principalement en RDC et en Ouganda, et ramenées au Rwanda pour y être jugées. Depuis mars 2014, au Rwanda, 14 personnes soupçonnées de connivence avec les FDLR ont disparu. Dans au moins huit des cas, des témoins ont vu des agents de l’État être présents au moment des enlèvements. […]
Jusqu’à ce jour, ces 14 personnes demeurent introuvables malgré les multiples démarches de leurs proches, qui ont frappé à toutes les portes de l’administration afin de savoir ce qu’il était advenu des disparus. Selon toute vraisemblance, ces personnes portées disparues seraient détenues au secret dans des camps militaires où elles risquent d’être interrogées sous la contrainte, voire sous la torture, afin de leur extorquer des informations et des aveux de culpabilité.
Une législation qui interdit les enlèvements
Bien que le Rwanda n’ait pas encore ratifié la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, son code pénal interdit « l’enlèvement » et la « détention illégale ». toutefois, l’acte de « disparition forcée » n’étant pas défini comme un crime en droit, les familles de disparus n’ont que peu de recours envisageables pour retrouver leurs parents disparus, à part le bon vouloir des autorités.
==> Pour en savoir plus, consulter la fiche du pays dans le rapport 2014 « Un monde tortionnaire » de l’ACAT-France sur le site :http://unmondetortionnaire.
*************************
Petit mode d’emploi :
Pour agir : écrivez au Président de la République (doc) avant le mercredi 15 octobre 2014
• Préciser votre nom, prénom, adresse et pays
• Signer
• Affranchir à 0,95€
• Envoyer à l’adresse mentionnée sur la lettreDepuis mars 2014, au moins 14 personnes ont été victimes de disparitions forcées au Rwanda, après avoir été arrêtées par des éléments des forces de défense et de sécurité. Leurs proches les recherchent en vain auprès des autorités. Ces dernières leur indiquent simplement que des enquêtes sont en cours. un flou qui renforce l’anxiété des familles de disparus.
Un régime qui a peur
Lors d'un déplacement dans l'ouest du pays, début juin 2014, le président Paul Kagamé a expliqué aux habitants du district de Nyabihu : « Nous ne pouvons laisser personne compromettre notre sécurité et notre développement. Ceux qui chercheront à déstabiliser le pays continueront à être arrêtés. on pourrait même être amené à les tuer en plein jour ». Le pouvoir en place à Kigali est persuadé que le pays est en proie à une menace sécuritaire imminente venant de République Démocratique du Congo (RDC) : des infiltrations d’éléments des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) - groupe armé rwandais basé en RDC - seraient en cours.
Une vague de répression
Pour le Rwanda, tous les moyens semblent être bons pour pallier cette menace. Ces dernières années, plusieurs personnes accusées de vouloir attenter à la sûreté de l’État ont été assassinées à l’étranger. D’autres ont été kidnappées dans les pays avoisinants, principalement en RDC et en Ouganda, et ramenées au Rwanda pour y être jugées. Depuis mars 2014, au Rwanda, 14 personnes soupçonnées de connivence avec les FDLR ont disparu. Dans au moins huit des cas, des témoins ont vu des agents de l’État être présents au moment des enlèvements. […]
Jusqu’à ce jour, ces 14 personnes demeurent introuvables malgré les multiples démarches de leurs proches, qui ont frappé à toutes les portes de l’administration afin de savoir ce qu’il était advenu des disparus. Selon toute vraisemblance, ces personnes portées disparues seraient détenues au secret dans des camps militaires où elles risquent d’être interrogées sous la contrainte, voire sous la torture, afin de leur extorquer des informations et des aveux de culpabilité.
Une législation qui interdit les enlèvements
Bien que le Rwanda n’ait pas encore ratifié la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, son code pénal interdit « l’enlèvement » et la « détention illégale ». toutefois, l’acte de « disparition forcée » n’étant pas défini comme un crime en droit, les familles de disparus n’ont que peu de recours envisageables pour retrouver leurs parents disparus, à part le bon vouloir des autorités.
==> Pour en savoir plus, consulter la fiche du pays dans le rapport 2014 « Un monde tortionnaire » de l’ACAT-France sur le site :http://unmondetortionnaire.
*************************
Petit mode d’emploi :
Pour agir : écrivez au Président de la République (doc) avant le mercredi 15 octobre 2014
• Préciser votre nom, prénom, adresse et pays
• Signer
• Affranchir à 0,95€
• Envoyer à l’adresse mentionnée sur la lettre
Depuis mars 2014, au moins 14 personnes ont été victimes de disparitions forcées au Rwanda, après avoir été arrêtées par des éléments des forces de défense et de sécurité. Leurs proches les recherchent en vain auprès des autorités. Ces dernières leur indiquent simplement que des enquêtes sont en cours. un flou qui renforce l’anxiété des familles de disparus.
Un régime qui a peur
Lors d'un déplacement dans l'ouest du pays, début juin 2014, le président Paul Kagamé a expliqué aux habitants du district de Nyabihu : « Nous ne pouvons laisser personne compromettre notre sécurité et notre développement. Ceux qui chercheront à déstabiliser le pays continueront à être arrêtés. on pourrait même être amené à les tuer en plein jour ». Le pouvoir en place à Kigali est persuadé que le pays est en proie à une menace sécuritaire imminente venant de République Démocratique du Congo (RDC) : des infiltrations d’éléments des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) - groupe armé rwandais basé en RDC - seraient en cours.
Une vague de répression
Pour le Rwanda, tous les moyens semblent être bons pour pallier cette menace. Ces dernières années, plusieurs personnes accusées de vouloir attenter à la sûreté de l’État ont été assassinées à l’étranger. D’autres ont été kidnappées dans les pays avoisinants, principalement en RDC et en Ouganda, et ramenées au Rwanda pour y être jugées. Depuis mars 2014, au Rwanda, 14 personnes soupçonnées de connivence avec les FDLR ont disparu. Dans au moins huit des cas, des témoins ont vu des agents de l’État être présents au moment des enlèvements. […]
Jusqu’à ce jour, ces 14 personnes demeurent introuvables malgré les multiples démarches de leurs proches, qui ont frappé à toutes les portes de l’administration afin de savoir ce qu’il était advenu des disparus. Selon toute vraisemblance, ces personnes portées disparues seraient détenues au secret dans des camps militaires où elles risquent d’être interrogées sous la contrainte, voire sous la torture, afin de leur extorquer des informations et des aveux de culpabilité.
Une législation qui interdit les enlèvements
Bien que le Rwanda n’ait pas encore ratifié la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, son code pénal interdit « l’enlèvement » et la « détention illégale ». toutefois, l’acte de « disparition forcée » n’étant pas défini comme un crime en droit, les familles de disparus n’ont que peu de recours envisageables pour retrouver leurs parents disparus, à part le bon vouloir des autorités.
==> Pour en savoir plus, consulter la fiche du pays dans le rapport 2014 « Un monde tortionnaire » de l’ACAT-France sur le site :http://unmondetortionnaire.
*************************
Petit mode d’emploi :
Pour agir : écrivez au Président de la République (doc) avant le mercredi 15 octobre 2014
• Préciser votre nom, prénom, adresse et pays
• Signer
• Affranchir à 0,95€
• Envoyer à l’adresse mentionnée sur la lettre
17 Aout 2008 Johannesburg
Présenté par Dr Jean-Baptiste MBERABAHIZI
Secrétaire général des Forces Démocratiques Unifiées, FDU-Inkingi1
Chers camarades,
Avec ses 26.338 km², une population de 9,2 millions d’habitants et un produit intérieur brut de 238 USD par an et par habitant, le Rwanda est un pays pauvre, quasiment non industrialisé, divisé et dominé. L’espérance de vie y était de 45 ans en 2005. Plus de 60% de Rwandais vivent avec moins de 1 USD par jour. 90% de ses habitants vivent à la campagne.
D’un point de vue matérialiste historique, la société rwandaise est passée successivement du mode de production primitif, au mode de production féodal, au mode de production capitaliste colonial et enfin au mode de production capitaliste néocolonial. Ainsi, quels que soit leur degré de développement, le féodalisme et le capitalisme sont les deux régimes sociaux dominants ces cinq derniers siècles. Le régime féodal a duré 4 siècles. Le régime capitaliste étapes successives, colonial et néocolonial, dure depuis plus d’un siècle.
Le régime féodal
L’Etat précolonial rwandais s’est formé à partir des chefs de lignages « Abakuru b’Imiryango ». Ensuite, il est le résultat d’une lutte « entre la houe et le bâton » , une lutte entre des chefs de lignages d’agriculteurs et des chefs de lignages pastoraux. Les agriculteurs étaient des Hutus. Les pasteurs étaient des Tutsis. L’issue de ces luttes souvent sanglantes est l’unification du Rwanda et la formation d’un Etat centralisé régenté par un monarque de droit, issue d’une dynastie, celle des Banyiginya, dont l’origine serait céleste. Un mythe veut en effet que les Banyiginya ainsi que tous les clans associés à leur pouvoir, les Baha, les Bakono, les Bega, les Bashambo et les Batsobe, soient des «Bimanuka », ceux qui sont descendus du ciel. Ils seraient les fils de « Gihanga », le créateur. En réalité, ils sont venus du Nord, probablement de l’Ouganda actuel. Ils auraient été acceuillis par le Mwami hutu Kabeja, roi du royaume du Mubari, situé au nord-est, à la frontière entre l’Ouganda, le Rwanda, et la Tanzanie.
L’esclavage a apparemment existé au Rwanda. Il ne s’est pas très développé. Il a laissé des traces puisque le mot « shebuja », signifie littéralement « père dans l’esclavage ». La traite des esclaves a en revanche touché légèrement le Rwanda. Il y eut en effet un marché d’esclaves à Rukara, dans l’est du Rwanda. Les esclaves vendus sur ce marché prenaient le chemin de l’est en direction de Tabora, en Tanzanie. Ce circuit alimentait la traite du trafiquant d’esclaves « Tipu Tipu » qui venait vraisemblablement du Sultanat de Zanzibar. Il a surtout visé ceux qui étaient jugés insubordonnés « abagome » par les chefs « abatware » et les maîtres « shebuja » tutsis. Ainsi c’est plutôt le régime féodal qui a marqué la société rwandaise.
Le régime féodal hutu : ubukonde
Avant le 14ème siècle, sur le territoire du Rwanda actuel, se trouvaient plusieurs entités autonomes dirigées par des « Bami » hutus. L’économie dominante de ces petits royaumes est agricole. Le mode de production en vigueur est de moins en moins primitif et de plus en plus féodal. Il devient franchement féodal à la veille du 16ème siècle. La société est alors divisé en propriétaires terriens primaires « Abakonde » et en paysans parcellaires « Abagererwa ». « Umukonde » signifie celui qui a défriché la forêt. « Umugererwa », du verbe « kugererwa » çàd « mesurer », signifie littéralement celui à qui on donne une mesure, une portion. La propriété privée n’existe pas. La terre, « isambu » appartient à la communauté, au lignage ou au sous-lignage « inzu », à la famille « umuryango » et est gérée par le chef de famille « umukuru w’umuryango ».
Le « mukonde » acceptait de donner en location un lopin de terre à un « mugererwa » pour nourrir sa famille. Le « mugererwa » et donnait au « mukonde » une houe pour sceller la relation, devait s’assurer que sa famille donne des présents « amaturo » à chaque récolte et lui porte assistance en toutes circonstances. Ces « Bami » sont aussi administrateurs des terres « Abahinza » et sont des pluviateurs. Ils président aux cérémonies de semailles et de moisson « umuganura ».
Ils sont généralement issus de trois grands clans, le clan des Bazigaba, le clan des Bagesera et le clan desBasinga. On les appelle « abasangwabutaka », ceux qu’on trouve sur leur terre. Ce sont eux qui présideront aux cérémonies d’accueil des immigrants, « gutera ubuse ». Ce sont eux qui ont conservé et transmis l’organisation de l’Etat rwandais émergent. Un lignage dominant, les Barenge, avait ainsi une organisation étatique perfectionnée qu’on suspecte d’être issu du Zimbabwe, du « Mwene mutapa ».
Le régime « ubukonde » était peu exploiteur et peu étendu. Il liait très peu de paysans, ne comportait pas d’obligations de prestation de travail gratuit et n’était en vigueur que dans quelques régions, notamment du nord-ouest (Gisenyi, Ruhengeri) et du sud-ouest (Cyangugu).
Le régime féodal tutsi : « uburetwa » et « ubuhake »
A partir du 16ème siècle jusqu’à l’arrivée des colonialistes, des chefs de lignages pastoraux issus du clan des Banyiginya unifièrent, plutôt par la violence, les différents petits royaumes sous leur férule et les incorporèrent au fur et à mesure dans le royaume du Rwanda. Ils s’associèrent aux clans des Bashambo, Baha, des Bakono, des Batsobe, des Bega et des Bahondogo. Ils organisèrent plusieurs expéditions destinées à annexer les royaumes de leurs rivaux et à étendre leur règne sur un territoire de plus en plus grand. A l’arrivée des colonialistes allemands à la fin du 19ème siècle (1897), ce mouvement n’est pas encore achevé.
Sous la dynastie nyiginya, deux régimes féodaux « ubuhake » et « uburetwa » se développèrent et s’étendirent sur une grande partie du territoire du Rwanda actuel. La terre est le principal moyen de travail. L’agriculture et l’élevage sont les principales activités de production. Les principaux moyens de travail sont la houe pour les cultivateurs et le bâton, pour les pasteurs. Il existe un secteur artisanal assez développé. On travaille le fer « ubutare » et le cuivre « umuringa ». Une corporation de forgerons « abacuzi » fabrique les armes (poignards, lances et flèches) ainsi que les instruments de travail (haches, houes, serpettes et couteaux). Une autre corporation de tanneurs « abakannyi » fabrique des vêtements en peau de bête. On travaille également le sisal, le ficus et d’autres matières. Il existe un marché où la règle est le troc « kugurana ». Il y a deux principales classes sociales, les féodaux et les paysans.
Le régime « Ubuhake »
Dans le régime « Ubuhake », un « mugaragu » recevait une vache de son maître « shebuja ». En échange, la famille du « mugaragu » devait lui obéir et lui porter assistance en tout moment. Les conquêtes de terres permirent aux Bami nyiginya de disposer à leur guise des terres prises aux royaumes conquis. Dans un premier temps, les pasteurs nyiginya, ega, ha, kono hondogo, et shambo de faire paitre leurs troupeaux sur les terres des paysans. Ensuite, ces terres furent confisquées. Les Bami nyiginya les donnaient à leurs vassaux « bagaragu ». Ce fut la naissance des fiefs, « ibikingi », qui privèrent les paysans de terres. Le régime féodal « ubuhake » pouvait lier des Tutsis aux Tutsi pauvres et au Hutus. Il a reçu plus d’écho dans les études, mais les contraintes qu’il imposait aux « bagaragu » étaient sans commune mesure avec les celles imposées aux seuls paysans hutus sous le régime « uburetwa ».
Le régime « uburetwa »
Dans le régime « uburetwa », avait le droit de travailler une terre située dans le fief « igikingi » du chef « umutware ». Pour ce faire, le paysan chef de famille devait désigner dans sa famille ceux qui devaient travailler deux jours par semaine (cinq jours pour la semaine traditionnelle rwandaise) sur les terres du « shebuja ». Ce régime avait un caractère exceptionnellement ségrégationniste. En effet, seuls les paysans hutu y étaient soumis. Les Tutsis en étaient exemptés. Les paysans hutus travaillaient gratuitement 2 jours sur 5 pour leurs maîtres, qui étaient généralement des Tutsi. Ces prestations étaient appelées « gufata igihe ». La nature des corvées dépendait du bon vouloir du féodal. Cela pouvait aller des corvées domestiques au portage, « guheka » puisque le Rwanda n’avait pas la culture de la roue. Les travaux dits d’intérêt général (TIG), peine dite alternative instituée par le régime en place aujourd’hui et auxquels ne sont condamnés que les personnes poursuivies pour génocide (généralement des Hutu) rappellent ce régime de corvées puisque les Tutsis n’y sont pas condamnés.
Ce régime féodal a été structuré et étendu par le régime colonial. En effet, pendant la colonisation belge, de 1916 à 1962, il était en vigueur dans pratiquement toutes les chefferies de la colonie, soit 46 alors qu’il ne sévissait que sur un tiers du territoire, avant l’arrivée des colonialistes. De plus, alors que les prestations de travail étaient exigées de la famille, sous la responsabilité du chef de famille, elles furent désormais exigées de l’individu, du corvéable, à raison d’un jour par semaine (de sept jours). Ce système a contribué à sceller une alliance objective entre les féodaux tutsis et les colonialistes belges.
Le régime capitaliste colonial
Le régime colonial rwandais a été marqué par deux épisodes : l’imposition du protectorat allemand de 1897 à 1916 et le placement du Rwanda sous mandat belge puis sous tutelle belge de 1916 à 1959, respectivement après la fin de la première guerre mondiale et après la fin de la deuxième guerre mondiale .
Le régime colonial allemand
L’arrivée des colonialistes allemands a coincidé avec une période de crise de la dynastie nyiginya. La succession du « Mwami » régnant Kigeli IV Rwabugiri a été marquée par des luttes entre les Bega et les Bakono d’une grande intensité. En 1899, Rwabugiri a désigné Rutalindwa, du clan des Bakono, comme co-régnant et successeur et Kanjogera, du clan des Bega, comme reine mère adoptive. En 1896, un an après la mort du Mwami Kigeli IV Rwabugiri, la reine mère Kanjogera avec l’aide de ses frères Kabare et Ruhinankiko, organise un coup d’Etat contre son fils adoptif Rutalindwa. Son fils Musinga, étant encore inapte à gouverner, elle devient régente du royaume. Mais, son pouvoir est contesté dans tout le pays.
Entre 1897 et 1913, plusieurs insurrections éclatent dans le pays, surtout au nord et à l’est. Pour protéger son pouvoir et assurer la sécurité de son fils, elle accepte des présents ainsi qu’une lettre de protection des mains du Capitaine Von Ramsay, faisant ainsi du Rwanda un protectorat allemand. Les Allemands aideront ainsi Kanjogera, puis son fils Yuhi IV Musinga mater les rébellions.
En 1900, Rukara, un descendant de Kimenyi, Mwami du Gisaka, précédemment annexé au Rwanda, refuse l’autorité de Musinga et proclame l’indépendance du Gisaka. Il est mâté par le chef du district d’Usumbura au Burundi, Graewert. Rukara est capturé. Il meurt prison à Bukoba, en Tanzanie.
En 1905, Musinga monte une expédition militaire contre Basebya, chef twa du Mulera, qui refuse de payer les prestations exigées par le mwami. Les troupes envoyées par le mwami sont battues. Il fait appel aux Allemands pour venir à bout de cette insurrection.
En 1910, Rukara rwa Bishingwe, chef réputé au Mulera, assassine un missionnaire européen, le père Lupias, à la suite d’une querelle entre ce dernier et plusieurs de ses parents qui voulaient se soustraire à son emprise. Le résident allemand Gudovius organise une expédition punitive dont l’objectif est la soumission complète de la région au prix de la destruction des récoltes et des habitations. Plusieurs Hutu sont tués.
En 1911, Nyiragahumuza, l’une des veuves du « mwami » Rwabugiri, annonce que l’héritier du trône, Mibambwe IV Rutalindwa est encore vivant et se cache dans le nord du pays. Une révolte éclate contre le mwami Musinga et embrase le nord du Rwanda. La rébellion est matée par une intervention allemande et Nyiragahumuza est capturée.
Egalement en 1911, Ndungutse refuse l’autorité de Musinga et organise une une rébellion au nord du pays. Les troupes de Musinga s’avèrent incapables de défaire les troupes rebelles.
En 1912, les troupes allemandes attaquent le Buberuka, dans la région de Ruhengeri, où se sont réfugiés Ndungutse, Rukara rwa Bishingwe et Basebya. Ndungutse livre d’abord Rukara pour s’attirer la clémence des troupes allemandes, puis prend la fuite en Ouganda. Rukara et Basebya sont exécutés. Le lieutenant allemand Linde prend en charge la punition de la région. Les récoltes sont détruites, les habitations sont brûlées et la résistance est matée. Au total, au moins 50 personnes sont tuées.
Ainsi, au départ les colonialistes allemands s’allient aux féodaux du clan des Bega. Paul Kagame, est un descendant de la Reine-mère Kanjogera, par qui le Rwanda est devenu un protectorat allemand. Il se rend régulièrement en Allemagne où il reçoit souvent des soins médicaux.
Le régime colonial belge
Le régime colonial belge a uniformisé le territoire et étendu l’autorité du mwami. Ainsi, en 1925 l’administration belge occupe le Bukunzi, province bénéficiant d’un statut de protectorat au sud-ouest du Rwanda. La reine-mère de la région, Nyirandakunze, est tuée et le jeune mwami Ngoga meurt emprisonné à Kigali. En 1926 : Les troupes belges occupent le Busozo, dont le mwami vient de mourir, et en confient le commandement à un jeune notable de la cour (+Reyntjens, 1985, 102). Un mouvement messianique dit de Nyiraburumuke ou de Ndanga, fait se soulever les populations du Bugesera et du Gisaka. La force publique mate ce soulèvement en 1927.
Les colonialistes belges suppriment plusieurs tributs existants – dont, en 1924, les prestations en bétail et en vivres – imponoke, indabukirano et amaturo–, elle généralise l’uburetwa dont elle étend considérablement l’assiette à tout homme adulte valide sur l’ensemble du territoire rwandais et crée l’akazi, réquisition d’hommes pour effectuer des travaux d’intérêt public non rémunérés
Le régime colonial est donc en alliance politique avec le régime féodal. Sous ce régime, le Rwanda entre dans l’économie capitalisme mondiale. Il fournit des minerais (cassitérite, colombo-tantalite, wolframite, etc.) et des produits agricoles exportés en Europe (café, thé, pyrèthre et quinquina). Pour l’évacuation des produits, il fallait construire des routes. Aux corvées « uburetwa » vient ainsi s’ajouter « akazi » ou prestations obligatoires au profit des colonialistes (portage, construction de routes et de ponts, construction de bâtiments publics, travail obligatoire dans les plantations de thé, de café, de pyrèthre et de quinquina). Jusqu’à sa suppression au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la volonté d’éviter l’uburetwa constituera l’une des principales motivations de l’exil : 425.000 Rwandais quitteront le pays pour l’Ouganda et le Tanganyika.
Cette alliance ne s’est pas toujours passée sans crises. En particulier, en 1931, Musinga a été déposé par les colonialistes belges. Les troupes coloniales allemandes ne comptaient que quelques dizaines d’officiers et de sous-officiers allemands ainsi que 154 hommes de troupes africains. Pour faire face à la contre-offensive engagée par les troupes coloniales belges après l’attaque d’un poste colonial sur l’Ile Ijwi (actuellement en RDC), Musinga avait levée des troupes Indugaruga, pour aider les Allemands. Ils le remplacèrent par son fils Mutara III Rudahigwa jugé plus apte à obéir. Il fut déporté et mourut à Moba, en RDC. Dans les années 1950, Rudahigwa manifesta de moins en moins d’enthousiasme
Alors qu’il n’y avait que deux classes sociales, les féodaux et les paysans, le régime colonial a créé deux nouvelles classes sociales, toutes deux issues de la paysannerie. D’une part, une petite bourgeoisie et d’autre part, un embryon de prolétariat. Ces deux classes sociales sont majoritairement composées de Hutu. Liées aux paysans hutus astreints au régime féodal « uburetwa » et au régime colonial « akazi », ces deux classes sociales ont eu accès aux connaissances véhiculées par l’école coloniale. Ce sont elles qui serviront de ferment à la contestation de l’ordre féodal et de la monarchie nyiginya.
Une alliance objective se noua entre les paysans, les ouvriers et les petits bourgeois hutus contre l’ordre féodal et contre la monarchie nyiginya. Mais, la faiblesse idéologique des organisations qui naissent en 1950 ainsi que les manœuvres tactiques des colonialistes belges auront raison du mouvement anti-féodal. Le mouvement révolutionnaire rwandais dissocia les tâches de la révolution anti-féodale des tâches de la révolution anti-coloniale.
Cette erreur stratégique a grandement affecté l’histoire du Rwanda. Ainsi, les féodaux tutsis, alliés aux colonialistes allemands et belges pendant longtemps, purent se faire passer pour des révolutionnaires et des champions de la libération nationale. Leurs positionnements tactiques, tirant partie de l’essor du mouvement communiste international et en particulier de l’internationalisme prolétarien, leur permirent même d’organiser une contre-révolution infructueuse de 1959 à 1968 que même des révolutionnaires aguerris soutinrent, comme Che Guevara au Congo . Cette erreur fut à l’origine des drames qui suivirent la révolution de 1959.
Aujourd’hui encore, beaucoup de révolutionnaires se laissent prendre dans de telles manœuvres tactiques. Ainsi par exemple, tirant partie des luttes inter impérialistes qui opposent en Afrique noire, l’impérialisme français d’une part et l’alliance entre les impérialismes américain et britannique d’autre part, le Front patriotique rwandais, ciblant la France, trompe la vigilance de la plus part des révolutionnaires africains, alors même que le régime qu’il a mis en place est un régime néocolonial américano-britannique.
Le mouvement révolutionnaire des années 1950 a réussi à imposer le démantèlement des fiefs- ibikingi-, l’abolition des régimes féodaux « ubuhake » et « uburetwa » ainsi que la fin de la monarchie et la proclamation de la république, en 1961. En revanche, il n’a pas permis aux Rwandais de se défaire du colonialisme. Entre 1965 et 1968, des rectifications idéologiques internes au parti au pouvoir, le Mouvement Démocratique Républicain, influencées par les nationalistes tanzaniens sous la direction de Mwalimu Julius Nyerere, a insufflé à la révolution rwandaise, une impulsion nouvelle. Ainsi, la Constitution du Rwanda fut revue pour inclure dans le projet national le principe du socialisme démocratique, un concept progressiste dans les conditions rwandaises d’alors.
Mais, cela n’empêcha pas que le Rwanda tombe sous domination néocoloniale française après 1975.
Le régime néocolonial
Les erreurs de la révolution de 1959 ont poussé à l’exil, essentiellement dans les pays voisins, Burundi, Congo, Ouganda et Tanzanie, 150.000 Tutsis . Ils y rejoignirent ainsi 425.000 Hutus qui avaient fui le régime féodal « uburetwa » entre 1897 et 1950. Ils y rejoignirent également, plusieurs centaines de milliers d’autres installés par le pouvoir colonial belge dans le cadre de sa politique de transfert de force de travail du Rwanda le Congo, pour en faciliter l’exploitation coloniale.
De 1962 à nos jours, le Rwanda est entré dans un régime néocolonial. Pendant cette période, la petite bourgeoisie s’est étendue grâce à l’extension du salariat. Comme partout ailleurs en Afrique , la consolidation de l’entrée du Rwanda dans les circuits de l’économie capitaliste mondiale a permis la naissance d’une autre classe : la bourgeoise politico administrative et compradore.
Deux éléments fondent la particularité de la bourgeoisie politico administrative et compradore rwandaise par rapport au reste de l’Afrique. Premièrement, elle est généralement ethnique et non nationale. Deuxièmement, la fraction au pouvoir se lie à l’une ou l’autre impérialisme occidental dont elle sert de relais.
Entre 1962 et 1973, l’économie néocoloniale rwandaise ne s’est pas assez développée pour créer une telle classe. La classe dominante était la petite bourgeoisie hutue. Ses liens avec le capitalisme belge, un capitalisme sans envergure, n’ont jamais permis le développement d’une bourgeoisie digne de ce nom.
Entre 1973 et 1994, après le coup d’Etat des militaires originaires du Nord du Rwanda, un essor assez significatif de l’économie néocoloniale rwandaise a permis la constitution d’une bourgeoisie politico administrative et compradore, liée par un Accord de coopération militaire à la France. Cet essor n’a été stoppé que par la guerre lancée en 1990 par le Front patriotique rwandais, un amalgame entre les contre-révolutionnaires tutsi des années 1960 et la petite bourgeoisie issue des 150.000 réfugiés tutsis des années 1960, sous la direction de sa fraction anglophone née et éduquée en Ouganda.
La bourgeoisie politico administrative et compradore tutsie
Depuis 1994, une nouvelle bourgeoisie politico administrative et compradore tutsie s’est formée. Elle a réalisée son accumulation primitive par l’expropriation de l’ancienne bourgeoisie politico administrative hutue, le pillage de la République Démocratique du Congo , la main basse sur les entreprises publiques par le biais de la privatisation des entreprises publiques opérant dans différents secteurs (thé, café, riziculture, industrie, mines, énergie, télécommunications, finance, hôtellerie & tourisme) seule ou en joint-ventures , l’aide bilatérale du capitalisme occidental, essentiellement, les USA et le Royaume-Uni et multilatérale (Banque mondiale et Union Européenne), ainsi et surtout par le siphonage du revenu national au détriment de la paysannerie . On sait par exemple, que les 10% les plus riches au Rwanda, concentrent en leurs mains, 38% du revenu national.
Les trois principales contradictions de la société rwandaise
Il résulte de tout ce qui a été dit qu’il y a trois contradictions majeures au Rwanda: le question ethnique, la question sociale et la question nationale.
La question ethnique
Elle est le fait de l’exclusion ethnique. L’exclusion ethnique fait qu’il n’y a pas de correspondance entre l’Etat et la nation. L’Etat est mono ethnique alors que la nation est multi ethnique. De plus, les pratiques exclusions débouchent sur des conflits armés déstructurés dont les conséquences sont la destruction des ressources naturelles à commencer par les ressources humaines, le freinage de la croissance du marché intérieur dû à la discrimination et la création de clivages au sein des masses. Aujourd’hui les Hutus et les Rwandais issus de mariages mixtes sont les principaux exclus de la nation rwandaise, au nom de la prévention ou de la répression du génocide.
La question sociale
Elle est le fait de l’accaparement des terres et du revenu national par une clique politico administrative et compradore liée à la globalisation capitaliste. Liant son intérêt à celui du capitalisme mondial, elle participe de l’appropriation de la valeur ajoutée créée par l’économie néocoloniale rwandaise. A titre d’exemple, alors que 60% des Rwandais en général et 80% en milieu rural, vivent avec moins d’1 USD par an et que le revenu moyen par habitant est de 220 USD par an, le revenu mensuel du Président Paul Kagame est de près 26.000 USD par mois.
La question nationale
Depuis l’arrivée des colonialistes allemands, les cliques dirigeantes rwandaises se sont toujours alliées à l’impérialisme occidental pour arriver au pouvoir ou s’y maintenir. L’aristocratie tutsie s’est alliée aux colonialistes allemands et belges entre 1897 et 1950. La petite bourgoisie hutu au pouvoir après 1962 s’est alliée au capitalisme belge de 1959 jusqu’en 1968. De 1973 à 1994, la bourgeoisie politico administrative hutu issue s’est alliée au capitalisme français. Depuis, 1994, la bourgeoisie politico administrative et compradore tutsie est au service des intérêts de l’impérialisme américano-britannique.
Paul Kagame a ainsi justifié et approuvé la guerre néocoloniale que les Etats-Unis et le Royaume-Uni mènent en Irak. La guerre d’agression déclenchée le 02 août 1998 contre le gouvernement nationaliste congolais dirigé par Laurent-Désiré Kabila était une guerre néocoloniale américano-britannique, sous-traitée aux troupes de Paul Kagame. Elle continue encore au Nord Kivu, sous la couverture de la milice du Conseil National pour la Défense du Peuple, CNDP dirigé par les anciens officiers de l’Armée patriotique rwandaise, Laurent Nkundabatware et Jean-Bosco Ntaganda.
La tâche de la révolution démocratique nationale rwandaise est de résoudre ces trois questions et faire du Rwanda, un Etat démocratique, non ethnique et indépendant, solidaire des autres peuples d’Afrique, au lieu d’être le point de départ d’agressions impérialistes contre d’autres Etats africains. Cette tâche requiert la solidarité de tous les révolutionnaires. Elle ne peut être menée à bien qu’à travers un front démocratique et national. Ce front est en marche. Il s’agit des Forces démocratiques unifiées. Les FDU comptent d’abord sur la force des masses rwandaises, mais elles ne peuvent mener ce combat dans l’isolement. La solidarité des autres peuples opprimés ne peut qu’accélérer la victoire des forces démocratiques sur les forces de l’exclusion.
Johannesburg, Août 2008
Joseph Mbwiliza, "The Hoe and the Stick: A Political Economy of the Heru Kingdom,"
René Lemarchand, Vansina, Jan. – Le Rwanda ancien : le royaume Nyiginya. Paris, Karthala, 2001, cartes, 289 p., Cahiers d'études africaines, 171, 2003
http://etudesafricaines.revues.org/document1540.html
Viret Emmanuel , Rwanda Index chronologique (1867-1994) Avril 2008
http://www.massviolence.org/Article?id_article=108
Che GuevaraErnesto, The African Dream: The Diaries of the Revolutionary War in the Congo,
New York: Grove Press, 1999, (2000, English translation), 244pp.
http://www.etext.org/Politics/MIM/bookstore/books/africa/checongo.html
SHIVJI Issa, Class Struggles in Tanzania
Rapport final du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la République Démocratique du Congo,
http://www.grip.org/bdg/g2044.html
Visiter ce site pour en savoir plus http://www.privatisation.gov.rw/
USAID 2006 Congressional Budget Justification for Rwanda
http://www.usaid.gov/policy/budget/cbj2006/afr/rw.html
DFID DFID’s Three Year Plan for Rwanda (2003-2006)
http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/caprwanda.pdf
UNDP Turning Vision 2020 into Reality: From Recovery to Sustainable Human Development, 119pp.
http://78.136.31.142/en/reports/nationalreports/africa/rwanda/RWANDA_2007_en.pdf
Hakizimana Emmanuel : Le développement économique au Rwanda : miracle ou mirage? Le Soleil, lundi 14 juillet 2008, http://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=87
United Democratic Forces, UDF_Political Programme
http://www.fdu-rwanda.org/fileadmin/user_upload/home/fichiers/Political_Programme_udf_rwanda.pdf
Emmanuel Viret, Chronologie du Rwanda (1867- 1994), Encyclopédie en ligne des violences de masse, : http://www.massviolence.org/Chronologie-du-Rwanda-1867-1994, ISSN 1961-9898
Sommaire

Les chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), réunis pour leur 34è Sommet ordinaire du 17 au 18 août 2014 à Victoria Falls (Zimbabwe),
ont appelé l’Onu à « accueillir temporairement les éléments des FDLR qui ont déposé les armes volontairement dans des pays tiers en dehors de la région des Grands Lacs ».
« En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le Sommet a appelé les Nations Unies, en coopération avec l’Union africaine, à apporter son concours en rapatriant les éléments des FDLR qui se sont rendus et ont déposé les armes volontairement, et en les accueillant temporairement dans des pays tiers en dehors de la région des Grands Lacs », ont décidé les 10 chefs d’Etat, dont le président rd-congolais Joseph Kabila Kabange, les 2 vice-présidents et 2 Premiers ministres présents à ce Sommet.
Après avoir « entériné la décision prise par la dernière réunion ministérielle conjointe SADC/CIRGL qui prévoit que la reddition et le désarmement volontaires des FDLR devront être effectués dans un délai de six mois », ils ont jugé que « ce processus pourrait être conduit dans un délai de six mois comme convenu entre la SADC et la CIGRL ».
Stratégie de la SADC pour la transformation économique
Le Sommet de Victoria Falls, qui s’est tenu autour du thème « Stratégie de la SADC pour la transformation économique : Mise à profit des diverses ressources de la région pour le développement économique et social durable par l’enrichissement et la valeur ajoutée », a élu le président zimbabwéen Robert Gabriel Mugabe et le lieutenant-général botswanais Seretse Khama Ian Khama de la République respectivement à la présidence et à la vice-présidence de la SADC.
Il a également élu le chef de l’Etat sud-africain Jacob Gedleyihlekisa Zuma et le Premier ministre Thomas Motsoahae Thabane du Royaume du Lesotho à la présidence et à la vice-présidence de l’Organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité.
COMMUNIQUÉ DU 34ème SOMMET DES CHEFS D’ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA SADC
VICTORIA FALLS (ZIMBABWE) : 17 – 18 AOÛT 2014
Le 34e Sommet ordinaire des Chefs d’État et de gouvernement de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) s’est tenu à Victoria Falls (République du Zimbabwe) les 17 et 18 août 2014.
Le Sommet s’est tenu autour du thème: « Stratégie de la SADC pour la transformation économique : Mise à profit des diverses ressources de la région pour le développement économique et social durable par l’enrichissement et la valeur ajoutée ».
Le Sommet a élu S.E. le Président Robert Gabriel Mugabe de la République du Zimbabwe et S.E. le Lieutenant-général Seretse Khama Ian Khama de la République du Botswana à la présidence et à la vice-présidence de la SADC respectivement.
Le Sommet a également élu S.E. Jacob Gedleyihlekisa Zuma, Président de la République d’Afrique du Sud et S.E. Thomas Motsoahae Thabane, Premier ministre du Royaume du Lesotho à la présidence et à la vice-présidence de l’Organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité, respectivement.
Le Sommet a réuni les Chefs d’État et de gouvernement et ou leurs représentants suivants:
Botswana : S.E. le Président Lt. Gén. Seretse Khama Ian Khama
RDC : S.E. le Président Joseph Kabila Kabange
Lesotho : S.E. le Premier Ministre Thomas Motsoahae Thabane
Madagascar : S.E. le Président Hery Rajaonarimapianina
Malawi : S.E. le Président le Prof. Arthur Peter Mutharika
Maurice : S.E. le Premier ministre le Dr. Navinchandra Ramgoolam
Mozambique : S.E. le Président Armando Emilio Guebuza
Namibie : S.E. le Président Hifikepunye Pohamba
Seychelles : S.E. le Président James Alix Michel
Afrique du Sud : S.E. le Président Jacob Gedleyihlekisa Zuma
RU de Tanzanie : S.E. le Président Jakaya Mrisho Kikwete
Zimbabwe : S.E. le Président M. Robert Gabriel Mugabe
Angola : S.E. le Vice-président M. Manuel Domingos Vicente
Swaziland : S.E. le Premier ministre Sibusiso Barnabas Dlamini,
Zambie : S.E. le Vice-président, M. Guy Scott
Le Sommet a également vu la présence de S.E. la Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente de la Commission de l’Union africaine et de S.E. la Dr. Stergomena Lawrence Tax, Secrétaire exécutive de la SADC.
S.E. le président Robert Gabriel Mugabe, Président de la SADC et hôte du 34e Sommet a souhaité la bienvenue aux Chefs d’État et de gouvernement de la SADC et aux autres délégués en République du Zimbabwe. Il a rendu hommage au Président sortant de la SADC, S.E. le Président le Professeur Arthur Peter Mutharika de la République du Malawi pour avoir fait preuve de leadership dans la région au cours de son mandat.
Le Sommet a également entendu les chefs d’État et de gouvernement nouvellement élus, à savoir, le Président le Professeur Arthur Peter Mutharika de la République du Malawi et M. Hery Rajaonarimapianina, premier Président de la 4e République de Madagascar, qui ont prononcé leur premier discours, dans lesquels ils ont réaffirmé l’engagement de leurs gouvernements au programme d’intégration politique et régionale et de développement de la SADC.
Le Sommet a entendu un autre discours, celui de S.E. la Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente de la Commission de l’Union africaine (CUA) qui a exprimé l’engagement de l’Union africaine de travailler avec la SADC afin de renforcer les initiatives prises par la région en matière de paix et de sécurité, ainsi que dans les domaines prioritaires clés de mise en œuvre des programmes, dans le cadre de la Vision 2063 de l’Union africaine.
Le Sommet a félicité les peuples et les gouvernements de quatre (4) États membres de la SADC à savoir, l’Afrique du Sud, le Swaziland, Madagascar et le Malawi pour avoir tenu des élections pacifiques, libres, justes et crédibles entre les 33e et 34e Sommets ordinaires.
Le Sommet a félicité leurs Excellences Hery Rajaonarimapianina, Jacob Gedleyihlekisa Zuma et le Professeur Arthur Peter Mutharika pour avoir remporté les élections tenues dans leurs pays respectifs.
Le Sommet a entendu un rapport présenté par le Président sortant de l’Organe de coopération en matière de politique, défense et de sécurité de la SADC, S.E. M. Hifikepunye Pohamba, Président de la République de la Namibie. Ce rapport soulignait ce qui suit :
i) La région demeure généralement calme et stable.
ii)En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le Sommet a entériné la décision prise par la dernière réunion ministérielle conjointe SADC/CIRGL qui prévoit que la reddition et le désarmement volontaires des FDLR devront être effectués dans un délai de six mois. Il a également appelé les Nations Unies, en coopération avec l’Union africaine, à apporter son concours en rapatriant les éléments des FDLR qui se sont rendus et ont déposé les armes volontairement, et en les accueillant temporairement dans des pays tiers en dehors de la région des Grands lacs. Ce processus pourrait être conduit dans un délai de six mois comme convenu entre la SADC et la CIGRL.
iii) À propos de la République de Madagascar, le Sommet a réaffirmé son engagement à soutenir le pays dans le cadre des processus de dialogue et de réconciliation et de reconstruction nationale. Il a également appelé la communauté internationale à soutenir le processus de développement engagé par Madagascar et a exhorté l’ensemble des acteurs malgaches d’adhérer à la feuille de route de la SADC et d’assurer sa mise en œuvre intégrale.
iv) Au sujet du Royaume du Lesotho, le Sommet a encouragé les dirigeants du gouvernement de coalition de continuer à fournir la direction voulue pour trouver une solution politique durable à l’impasse actuelle et a souligné l’engagement de la SADC à soutenir les efforts qu’ils entreprennent à cette fin. Il a également appelé tous les dirigeants politiques et le peuple en général de s’abstenir de toute action ou déclaration pouvant nuire à la paix et à la stabilité dans le pays et a exhorté les acteurs politiques à résoudre les problèmes politiques conformément à la Constitution et aux lois du pays, conformément aux principes démocratiques.
Le Sommet a salué S.E. le Président Hifikepunye Pohamba pour avoir dirigé avec succès l’Organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC.
Le Sommet a souligné la nécessité d’honorer comme il se doit les dirigeants fondateurs qui ont rempli un rôle exceptionnel dans la libération de l’Afrique au niveau tant régional que continental.
Le Sommet a lancé la publication du Projet Hashim Mbita de la SADC, qui retrace l’histoire des luttes de libération nationale en Afrique australe ainsi que l’Annuaire statistique de la SADC. À cette fin, il a exhorté les États membres à un honorer le Brigadier-général Hashim Mbita, comme cela a été démontré par la République du Zimbabwe, qui a décerné la distinction la plus élevée du pays, à savoir l’Ordre du Munhumutapa, à un ressortissant étranger.
En ce qui concerne le thème, le Sommet a donné pour instruction qu’une place centrale soit accordée à l’industrialisation dans le programme d’intégration régionale de la SADC. Dans cette optique, il a mandaté le Groupe de travail ministériel sur l’intégration économique régionale d’élaborer une feuille de route pour l’industrialisation dans la région.
Le Sommet a pris note des progrès réalisés en matière de révision de Plan stratégique indicatif de développement régional (RISDP) et ordonné l’achèvement du Plan de mise en œuvre afin de fixer l’orientation nécessaire à la mise en œuvre des programmes de la SADC.
Le Sommet a entendu un rapport du Comité des Ministres de la Justice relatif sur les progrès réalisés dans les négociations d’un nouveau Protocole sur le Tribunal de la SADC et a adopté ce nouveau Protocole.
Le Sommet a reçu un rapport du Groupe de travail ministériel sur l’intégration économique régionale, qui souligne, entre autres, l’état du démantèlement des tarifs et des échanges intra-SADC. Il a également entendu un rapport d’avancement sur les négociations en cours à propos de la zone de libre-échange tripartite et a ordonné que les négociations de la ZLE tripartite soient conclues dans les meilleurs délais afin d’ouvrir la voie au processus d’instauration de la ZLE continentale.
Examinant la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle régionale, le Sommet a pris note des augmentations de la production alimentaire enregistrée au cours de la saison commerciale 2013-2014. Toutefois, l’aide humanitaire et la malnutrition continuent de poser problème. À cet effet, le Sommet a approuvé une stratégie régionale de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour la période 2015-2025 visant à assurer la durabilité des disponibilités, de l’accessibilité et de l’utilisation alimentaires.
Le Sommet a pris note des progrès réalisés en matière de représentation des femmes aux postes politiques et décisionnels et a exhorté les États membres à mettre en place les législations, les politiques et les stratégies nécessaires pour pérenniser les acquis enregistrés jusqu’à présent.
Le Sommet a pris note également des progrès réalisés dans la prévention et la lutte contre le VIH et le sida, la tuberculose et le paludisme, qui tendent toutes à diminuer. Il a examiné également les menaces posées par la maladie à virus Ebola et exhorté les États membres de poursuivre la mise en place des mesures nécessaires pour empêcher son éruption et la contenir de manière efficace en cas de flambée dans la région de la SADC.
Le Sommet a signé les instruments juridiques suivants :
(i) le Protocole sur le Tribunal de la Communauté de développement de l’Afrique australe ;
(ii) le Protocole sur la gestion de l’environnement pour le développement durable ;
(iii) le Protocole sur l’Emploi et le Travail ; et
(iv) la Déclaration sur le développement des infrastructures régionales.
Le Sommet a signé une Déclaration sur les petits États insulaires en développement en faveur du développement aquatique et océanique durable des petits États insulaires en développement dans la perspective de la tenue de la 3e Conférence des petits États insulaires en développement (PEID), qui se tiendra au Samoa en septembre 2014.
Le Sommet a appelé tous les États membres à soutenir pleinement la revendication légitime de la République de Maurice concernant le rétablissement de sa souveraineté sur l’archipel des Chagos, sans laquelle la décolonisation de l’Afrique reste incomplète.
Le Sommet a reconduit Mme Émilie Azaya Mushobekwa au poste de Secrétaire exécutive adjointe chargée des finances et de l’administration et a noté qu’en application du mandat que lui a confié le Sommet au Malawi en août 2013, le Conseil a nommé le Dr Thembinkosi Mhlongo au poste de Secrétaire général adjoint chargé de l’intégration régional.
Lors de la cérémonie de clôture officielle, le Sommet a entendu des déclarations d’adieu de S.E. le Président Armando Emilio Guebuza de la République du Mozambique et de S.E. le Président Hifikepunye Pohamba de la République de Namibie, dont les mandats présidentiels touchent à leur fin.
Dans son allocution, S.E. le Président Guebuza a salué la SADC pour les réalisations obtenus qu’elle a accomplies depuis sa création, la solidarité et le soutien fraternel qu’il a reçus des autres chefs d’État et de gouvernement, et les exhortés de soutenir son successeur.
Pour sa part, S.E. le Président Pohamba a déclaré au Sommet que cela a été un honneur pour lui d’avoir travaillé au cours des neuf dernières années avec ses collègues, les chefs d’État et de gouvernement de la SADC, et d’avoir œuvré de manière collective avec eux pour surmonter les défis surgissant en matière de paix et de sécurité tout en promouvant le programme d’intégration et de développement de la région de la SADC.
Le Sommet a été officiellement clôturée par le Président de la SADC, S.E. M. Robert Gabriel Mugabe, Président de la République du Zimbabwe
Le Vice-président du Sommet, S.E. le Lieutenant-général Seretse Khama Ian Khama de la République du Botswana, a présenté une motion de remerciements et a invité les Chefs d’État et de gouvernement et tous les délégués au prochain Sommet qui se tiendra à Gaborone en août 2015.
Le Sommet a exprimé sa gratitude au Gouvernement et au peuple du Zimbabwe pour l’organisation du Sommet et pour la chaleureuse hospitalité réservée à tous les délégués.
FAIT A VICTORIA FALLS (ZIMBABWE)
LE 18 AOÛT 2014
Source: Knack
jeudi 21 août 2014
La maladie d’Ebola, qui a déjà coûté la vie à au moins 1.229 personnes en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et au Nigéria touche une majorité de femmes. Voici pourquoi.

© Reuters
Comme les épidémies d’Ebola sont probablement dues aux animaux infectés, les hommes qui chassent les animaux et traitent leur viande sont les premiers infectés par le virus. Cependant, au fur et à mesure que la maladie se propage, ce sont surtout les femmes qui en sont victimes.
Selon Unicef, 55 à 60 pour cent des victimes décédées de l’épidémie actuelle au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone sont des femmes. "Les professionnels de la santé se composent surtout de femmes et elles se trouvent en première ligne de cette crise", explique Sia Nyama Koroma, la première dame de Sierra Leone au quotidien The Washington Post.
Selon la ministre libérienne de l'Égalité des sexes et du Développement, Julia Duncan-Cassell, 75 pour cent des victimes d’Ebola au Libéria sont des femmes. "Les femmes sont les premières dispensatrices de soins. Quand un enfant est malade, on lui dit ‘Va voir ta mère’. En outre, les femmes traversent la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone pour commercialiser leurs biens au marché. Et quand quelqu’un meurt dans la famille, c’est une femme qui prépare l’enterrement, généralement une tante ou une membre de la famille plus âgée".
Pas la même protection
Comme elles soignent les membres de leur famille, les femmes en Afrique de l’Ouest courent plus de risques de contracter le virus. En outre, les femmes aident aux accouchements et travaillent comme infirmières et femmes de ménage dans les hôpitaux où elles ne bénéficient pas du même soutien et de la même protection que les médecins, qui sont surtout des hommes.
Selon le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Libéria, Maricel Seeger, il est capital que les femmes soient sensibilisées afin de contrer la propagation du virus étant donné qu’elles jouent un rôle important d’"informatrices au sein de leur communauté".
Par Quinault-Maupoil, Tristan | LeFigaro.fr
 LE SCAN POLITIQUE - L'ancienne secrétaire d'État deNicolas Sarkozy remercie Christiane Taubira d'avoir fait voter une loi en 2001 reconnaissant l'esclavage comme un crime contre l'humanité.
LE SCAN POLITIQUE - L'ancienne secrétaire d'État deNicolas Sarkozy remercie Christiane Taubira d'avoir fait voter une loi en 2001 reconnaissant l'esclavage comme un crime contre l'humanité.
Rama Yade, l'ancienne secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères et des Droits de l'Homme, ne mêlera pas sa voix aux critiques récurrentes de la droite envers Christiane Taubira. Celle-ci peu compter sur la «reconnaissance éternelle» de la conseillère régionale d'Île-de-France. L'admiration de la jeune élue UDI envers son aînée date de 2001 et du vote de la loi Taubira qualifiant l'esclavage de crime contre l'humanité, rapporte l'hebdomadaire Le Point.
«Je ne suis pas communautariste, confie Rama Yade à l'hebdomadaire, mais je suis très attachée à ce combat.»
C'est grâce à la loi initiée par l'ex-députée PRG de Guyane que la France commémore l'abolition de l'esclavage tous les ans, le 10 mai.
En 2006, une quarantaine de députés de l'UMP emmenés par Lionel Luca, parlementaire des Alpes-Maritimes, s'était mobilisée contre une disposition du texte de Christiane Taubira visant à enseigner l'esclavage à l'école. Jean-Christophe Lagarde, actuel député UDI de Seine-Saint-Denis, avait regretté une «provocation inutile et aigrie à l'égard des Français originaires de l'Outre-mer et des descendants d'esclaves.»
RFI : Dix ans après le massacre du camp de réfugiés congolais banyamulenge de Gatumba tout près de Bujumbura au Burundi, les organisations de victimes et de défense des droits de l’homme comme Human Rights Watch réclament la fin de l’impunité. La responsabilité des FNL, à l’époque sous votre commandement, est pointée du doigt. Etes-vous responsable de cette attaque contre le camp de réfugiés banyamulenge ?
Agathon Rwasa : Moi, je ne suis pas responsable de cette attaque et même les Forces nationales de libération (FNL) ne peuvent pas être accusées d’une façon globale. Si l’un ou l’autre avait trempé dans ce genre de chose, il doit en répondre personnellement.
Alors pourquoi votre porte-parole Pasteur Habimana l’a revendiqué au nom de votre mouvement sur des radios nationales et internationales à l’époque ?
Il a revendiqué, c’est lui qui peut s’expliquer sur ses mobiles puisque, après tout, il ne m’a pas consulté pour dire ce qu’il a dit. Il l’a dit de son propre chef.
Mais vous-même, vous l’avez interrogé sur ce point. Que vous a-t-il dit ?
Je ne l’ai pas interrogé de façon formelle. Cependant l’instrumentalisation de cela, de la justice, c’est ça qui un tout petit peu écoeure puisqu’il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce pays. Et par rapport à ce dossier-là, je dois vous signaler que, par exemple, l’année dernière au mois de mars ou avril, il y a un groupe de Banyamulenge qui a écrit au secrétaire général des Nations unies, demandant justement que justice soit faite et ils ne m’incriminent pas du tout. Donc que ce soit Human Rights Watch, que ça soit qui que ce soit, il serait plus intéressant [qu’ils fassent] des enquêtes, sans toute partialité, et qu’ils établissent les responsabilités et qu’ils condamnent qui doit être condamné.
Mais il y a eu des enquêtes à l’époque. Il y a eu un rapport des Nations unies, il y a eu justement un rapport de Human Rights Watch. Et ce sont ces rapports qui vous ont incriminé à l’époque…
Ils m’incriminent comment ? Moi je n’ai pas été sur les lieux, je n’ai pas commandité ce qui s’est passé. Comment est-ce qu’on voudrait me faire porter ce chapeau ?
Gatumba n’est pas le seul crime commis à l’époque, à l’époque de la guerre. Que pensez-vous de la Commission vérité et réconciliation et êtes-vous prêt à collaborer ?
Les incidents qui se sont passés durant toute cette période de guerre, effectivement, sont nombreux. Il serait beaucoup plus judicieux de considérer tous les protagonistes dans ce conflit et ne pas être sectaire, et seulement regarder du côté FNL. Que ce soient ceux qui sont au pouvoir aujourd’hui, que ce soient ceux qui étaient au pouvoir avant eux, tout le monde a été dans ce sale décor. Maintenant parler de la Commission vérité et réconciliation, quelque part la façon dont on procède, laisse à désirer. La guerre qui a secoué le Burundi a touché chaque citoyen. Comment est-ce que maintenant le seul parti au pouvoir veut récupérer la situation ? Ne va-t-on pas assister à une Commission vérité et réconciliation faite pour dédouaner le CNDD-FDD [Conseil national pour la défense de la démocratie -Force de défense de la démocratie, parti au pouvoir] et pour incriminer les autres, histoire de barrer la route à quiconque prétendrait à aller dans la liste dans les élections prochaines.
Parlons de la lutte politique. Vous avez renoncé à la lutte armée. Vous êtes aujourd’hui opposant politique. Mais votre parti le FNL est divisé en deux. Une branche seulement a été reconnue par le gouvernement, mais pas la vôtre. Une réconciliation est-elle possible entre les deux branches du FNL ?
La réconciliation est bel et bien possible, seulement l’appât du gain ou les intérêts de ceux qui sont dans les bonnes mains du pouvoir peut-être handicapent ce processus-là. Mais je me dis qu’un politicien averti devrait se passer des offres ou des avantages qu’il peut croire être les siens aujourd’hui parce que je m’imagine que le décor politique en 2015 aura été quelque chose d’autre.
Si votre parti n’est pas retenu, comptez-vous faire campagne quand même en 2015 ?
Nous sommes déterminés à aller aux élections. Bientôt c’est l’enrôlement des électeurs. Nous devons nous faire enrôler et quand il faudra qu’on présente les listes dans différents scrutins, nous devrons absolument confectionner les nôtres et participer pleinement aux élections.
Ça veut dire que vous serez vous-même candidat à la présidentielle ?
Je ne saurais pas dire que je le serai parce que ça, c’est décidé par les autres. Mais si jamais on me le propose, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas ?
Quelque soit le candidat, que ce soit vous ou quelqu’un qui aura été désigné par vos membres, il n’aura que deux semaines de campagne électorale. Est-ce que ce n’est pas un problème pour pouvoir mener une campagne que de n’avoir que deux semaines ?
Deux semaines, c’est très peu et je crois que le pouvoir le fait sciemment. Le CNDD-FDD veut monopoliser le terrain et il empêche les autres formations politiques et les autres candidats potentiels de faire leur travail de terrain chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Il n’hésite pas à utiliser sa jeunesse pour rassurer les uns et les autres. C’est dommage que ça soit ainsi alors qu’on a convenu qu’on va tout régler par le dialogue et qu’on accepte le multipartisme comme système politique. Donc le moindre, c’est qu’on puisse respecter les règles du jeu. J’interpelle au sein du CNDD-FDD et le pouvoir en place pour justement faire leur cette idée-là que, en démocratie on a droit à la différence et c’est de cette différence qu’on pourra avoir quelque chose qui fasse avancer notre pays.
Ça veut dire que de votre point de vue, le parti au pouvoir ne respecte pas les accords d’Arusha et les accords subsidiaires ?
En quelque sorte, oui. Il y a le verbe et malheureusement il y a les faits qui contredisent cette adhésion aux accords d’Arusha et aux accords subsidiaires.

Massacre de Gatumba: les familles des victimes se réjouissent de l'ouverture d'une enquête visant Agathon Rwasa

Burundi: à peine réapparu, l'ancien chef rebelle Agathon Rwasa dans le collimateur de la justice

Burundi : Agathon Rwasa dans le collimateur de la justice

Agathon Rwasa: «Je dois parachever la lutte que j’ai commencée depuis plusieurs décennies au Burundi»

Burundi: la police empêche Agathon Rwasa de rejoindre ses partisans en meeting

Burundi: Agathon Rwasa prêt pour son grand retour

Burundi : Agathon Rwasa destitué de la tête des FNL

Burundi : le chef de l'ex-rébellion hutue, Agathon Rwasa, sort de son silence

Où est donc passé Agathon Rwasa ?
Martin Kobler, MONUSCO
A l’issue du sommet des chefs d'Etat de la Conférence internationale pour les Grands Lacs, un ultimatum a été lancé aux rebelles hutus rwandais du FDLR, qui ont jusqu’à décembre pour désarmer. Les avancées du processus seront évaluées au mois d'octobre et « l’option militaire reste sur la table », insiste Martin Kobler, le chef de la Monusco, la mission des Nations Unies en RDC. Il plaide également pour un retour des réfugiés Rwandais dans leur pays.
RFI : Les chefs d’Etats des Grands Lacs, réunis à Luanda cette semaine, ont accentué leur pression sur les FDLR. Les rebelles hutus rwandais ont jusqu'au 31 décembre pour désarmer. Comment réagissez-vous à cette annonce ?
Martin Kobler : Le message au FDLR, c’est de promouvoir le processus de reddition volontaire. C’est très important, parce que l’option militaire est sur la table.
Les chefs d’Etats n’ont pas été assez fermes, selon vous ? Il faut être plus exigeant avec les FDLR ?
Non, les chefs d’Etat et les ministres de la Défense ont été très fermes, et ont même autorisé l’option militaire contre ce groupe des FDLR qui ne rejoignent pas le processus de reddition volontaire. Pour nous, Monusco, c’est très important. Nous choisissons toujours la voie paisible d’abord. Nous ne voulons pas combattre les FDLR. Si c’est possible de désarmer volontairement, c’est la voie préférable. Mais si ça ne marche pas, l’option militaire est sur la table.
A quelle échéance envisagez-vous véritablement ce type d’action militaire ?
On a deux possibilités. Contre les troupes de FDLR qui ont annoncé la reddition volontaire, si on n’a pas de reddition volontaire à la fin de cette année, l’option militaire est sur la table. Tout le monde le dit, les chefs d’Etat le disent, le SADC le dit. Et pour ceux qui ont déjà annoncé qu’ils ne vont pas rejoindre le processus de reddition volontaire, on a déjà l’autorisation de planifier, d’opérationnaliser les actions militaires, maintenant.
Des actions militaires pourraient avoir lieu dès maintenant ?
Il faut le faire ensemble avec la RDC. Nos militaires sont en contact avec le chef de l’état-major congolais. La Monusco ne va pas mener des actions militaires seules, il lui faut coopérer avec l’armée congolaise dans les actions militaires.
Craignez-vous encore un enlisement, avec cet ultimatum qui court jusqu’au 31 décembre ? Ou êtes-vous maintenant plus confiant qu’auparavant ?
C’est un processus difficile. Je comprends beaucoup d’entre eux. Je l’ai vu dans la brousse : les ex-combattants sont des gens qui font une impression assez faible. Ils ont passé 20 ans dans la brousse. C’est une chose qui est très difficile, ce processus de reddition. Une chose qui est très importante : tous ceux qui veulent rentrer au Rwanda - ce sont des citoyens rwandais, des Rwandaises -, ils peuvent rentrer au Rwanda. J’encourage et je demande aux ex-combattants FDLR de saisir cette occasion, de rentrer au Rwanda avec leur famille pour une vie paisible.
Mais les rebelles du FDLR demandent de leur côté l’établissement d’un chronogramme pour organiser ce désarmement. Est-ce une bonne solution, selon vous ? C’est peut-être un bon moyen pour établir la bonne ou la mauvaise foi de ces FDLR.
On a fait un chronogramme, du 2 juillet jusqu’à la fin de l’année, avec une revue le 2 octobre. Nous avons maintenant défini les critères. Le gouvernement de la RDC a défini à peu près les mêmes critères. Les Etats membres de la SADC, les Etats membres de la CIRGL, de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, vont déterminer lors de cette réunion d’évaluation le 2 octobre si le décret de la reddition ça suffit ou pas.
Et si ça ne suffit pas ?
Si ça ne suffit pas, alors l’option militaire est sur la table.
On parle beaucoup des 1600 combattants du FDLR et, finalement, assez peu des milliers de réfugiés rwandais qui sont en territoire congolais. Qu’est-ce qui est prévu pour eux ?
C’est un problème séparé. Vous avez raison, il faut résoudre le problème des réfugiés. Ce ne sont pas seulement les réfugiés rwandais en RDC, ce sont aussi les réfugiés au Rwanda, des Congolais qui ne rentrent pas au Congo parce que les FDLR y sont. C’est une question régionale. Il faut apprécier le problème des réfugiés, parce qu’une famille de réfugiés est une famille réfugiée de trop. Ils doivent rentrer dans leur pays d’origine. On a 240 000 réfugiés rwandais ici, depuis 20 ans. On a aussi des réfugiés congolais au Rwanda, il faut résoudre le problème.
Selon l’ancien Premier ministre rwandais Faustin Twagiramungu, qui est maintenant opposant et allié politique des FDLR, la situation des réfugiés est aussi liée aux droits de l’homme, à l’absence d’ouverture politique au Rwanda qui empêche aux réfugiés de rentrer au Rwanda…
Je ne peux pas confirmer que nous avons une situation difficile pour les Rwandais qui sont en RDC et qui veulent rentrer au Rwanda. Depuis 2002, nous avons plus de 11 000 Rwandais, ex-combattants des FDLR, qui ont été rapatriés par le processus DDRRR [Désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration et réinstallation, NDLR]. Et c’est aussi possible pour les Rwandais. 11 000 ont décidé de rentrer.

Grands Lacs: nombreuses réactions après l'ultimatum lancé aux FDLR

Un ultimatum lancé aux FDLR à l’issue du sommet des Grands Lacs

Les combattants du FDLR veulent-ils vraiment désarmer?

RDC: échanges musclés entre les FDLR et Martin Kobler
A l’issue du sommet des chefs d'Etat de la Conférence internationale pour les Grands Lacs, un ultimatum a été lancé aux rebelles hutus rwandais du FDLR, qui ont jusqu’à décembre pour désarmer. Les avancées du processus seront évaluées au mois d'octobre et « l’option militaire reste sur la table », insiste Martin Kobler, le chef de la Monusco, la mission des Nations Unies en RDC. Il plaide également pour un retour des réfugiés Rwandais dans leur pays.
RFI : Les chefs d’Etats des Grands Lacs, réunis à Luanda cette semaine, ont accentué leur pression sur les FDLR. Les rebelles hutus rwandais ont jusqu'au 31 décembre pour désarmer. Comment réagissez-vous à cette annonce ?
Martin Kobler : Le message au FDLR, c’est de promouvoir le processus de reddition volontaire. C’est très important, parce que l’option militaire est sur la table.
Les chefs d’Etats n’ont pas été assez fermes, selon vous ? Il faut être plus exigeant avec les FDLR ?
Non, les chefs d’Etat et les ministres de la Défense ont été très fermes, et ont même autorisé l’option militaire contre ce groupe des FDLR qui ne rejoignent pas le processus de reddition volontaire. Pour nous, Monusco, c’est très important. Nous choisissons toujours la voie paisible d’abord. Nous ne voulons pas combattre les FDLR. Si c’est possible de désarmer volontairement, c’est la voie préférable. Mais si ça ne marche pas, l’option militaire est sur la table.
A quelle échéance envisagez-vous véritablement ce type d’action militaire ?
On a deux possibilités. Contre les troupes de FDLR qui ont annoncé la reddition volontaire, si on n’a pas de reddition volontaire à la fin de cette année, l’option militaire est sur la table. Tout le monde le dit, les chefs d’Etat le disent, le SADC le dit. Et pour ceux qui ont déjà annoncé qu’ils ne vont pas rejoindre le processus de reddition volontaire, on a déjà l’autorisation de planifier, d’opérationnaliser les actions militaires, maintenant.
Des actions militaires pourraient avoir lieu dès maintenant ?
Il faut le faire ensemble avec la RDC. Nos militaires sont en contact avec le chef de l’état-major congolais. La Monusco ne va pas mener des actions militaires seules, il lui faut coopérer avec l’armée congolaise dans les actions militaires.
Craignez-vous encore un enlisement, avec cet ultimatum qui court jusqu’au 31 décembre ? Ou êtes-vous maintenant plus confiant qu’auparavant ?
C’est un processus difficile. Je comprends beaucoup d’entre eux. Je l’ai vu dans la brousse : les ex-combattants sont des gens qui font une impression assez faible. Ils ont passé 20 ans dans la brousse. C’est une chose qui est très difficile, ce processus de reddition. Une chose qui est très importante : tous ceux qui veulent rentrer au Rwanda - ce sont des citoyens rwandais, des Rwandaises -, ils peuvent rentrer au Rwanda. J’encourage et je demande aux ex-combattants FDLR de saisir cette occasion, de rentrer au Rwanda avec leur famille pour une vie paisible.
Mais les rebelles du FDLR demandent de leur côté l’établissement d’un chronogramme pour organiser ce désarmement. Est-ce une bonne solution, selon vous ? C’est peut-être un bon moyen pour établir la bonne ou la mauvaise foi de ces FDLR.
On a fait un chronogramme, du 2 juillet jusqu’à la fin de l’année, avec une revue le 2 octobre. Nous avons maintenant défini les critères. Le gouvernement de la RDC a défini à peu près les mêmes critères. Les Etats membres de la SADC, les Etats membres de la CIRGL, de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, vont déterminer lors de cette réunion d’évaluation le 2 octobre si le décret de la reddition ça suffit ou pas.
Et si ça ne suffit pas ?
Si ça ne suffit pas, alors l’option militaire est sur la table.
On parle beaucoup des 1600 combattants du FDLR et, finalement, assez peu des milliers de réfugiés rwandais qui sont en territoire congolais. Qu’est-ce qui est prévu pour eux ?
C’est un problème séparé. Vous avez raison, il faut résoudre le problème des réfugiés. Ce ne sont pas seulement les réfugiés rwandais en RDC, ce sont aussi les réfugiés au Rwanda, des Congolais qui ne rentrent pas au Congo parce que les FDLR y sont. C’est une question régionale. Il faut apprécier le problème des réfugiés, parce qu’une famille de réfugiés est une famille réfugiée de trop. Ils doivent rentrer dans leur pays d’origine. On a 240 000 réfugiés rwandais ici, depuis 20 ans. On a aussi des réfugiés congolais au Rwanda, il faut résoudre le problème.
Selon l’ancien Premier ministre rwandais Faustin Twagiramungu, qui est maintenant opposant et allié politique des FDLR, la situation des réfugiés est aussi liée aux droits de l’homme, à l’absence d’ouverture politique au Rwanda qui empêche aux réfugiés de rentrer au Rwanda…
Je ne peux pas confirmer que nous avons une situation difficile pour les Rwandais qui sont en RDC et qui veulent rentrer au Rwanda. Depuis 2002, nous avons plus de 11 000 Rwandais, ex-combattants des FDLR, qui ont été rapatriés par le processus DDRRR [Désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration et réinstallation, NDLR]. Et c’est aussi possible pour les Rwandais. 11 000 ont décidé de rentrer.

Grands Lacs: nombreuses réactions après l'ultimatum lancé aux FDLR

Un ultimatum lancé aux FDLR à l’issue du sommet des Grands Lacs

Les combattants du FDLR veulent-ils vraiment désarmer?

RDC: échanges musclés entre les FDLR et Martin Kobler

Kabuye, a businessman, was picked up on Wednesday, two days after Rusagara’s arrest, the RDF spokesperson Brig. Gen. Joseph Nzabamwita told Saturday Times last evening.
Without giving further details, Nzabamwita said the duo was held in connection with State security offences.
“They are both in the hands of criminal investigation agencies,” he said, adding that the suspects’ families had duly been notified and due process was being observed.
He said investigations were still ongoing and that the two men would be produced before the courts of law in due course.
The New Times first reported about Rusagara’s arrest on Wednesday.
Before his retirement last year, Rusagara had completed his tour of duty as Defence Attaché to the United Kingdom.
Previously, he had served as permanent secretary, Ministry of Defence, and Commandant of the RDF Command and Staff College Nyakinama.
Contact email: editorial[at]newtimes.co.rw
Des affrontements ont opposé depuis jeudi les Forces armées de la RDC (FARDC) aux miliciens Mayi Mayi et aux rebelles burundais des Forces nationales de la libération (FNL) dans la province du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a-t-on appris de sources concordantes.
Des combats ont été signalés à Katonyera et Kazimwe, dans le groupement de Muhungu, en territoire d'Uvira, poussant les populations de ces deux localités à fuir.
L'armée a attaqué les positions des rebelles burundais qui administraient illégalement les deux localités, a déclaré à Xinhua un chef du 111ème régiment des FARDC de Kabunambo, sans donner le bilan de ces affrontements.
"Le groupement de Muhungu n'était pas sous occupation des FARDC depuis plus de 15 mois, la population de ce groupement était soumis à des taxes illégales imposées par les FNL", a fait savoir à Xinhua, Djafari Bya Dunia, journaliste indépendant basé dans la cité de Sange.
Par ailleurs, depuis mercredi, le groupe armé Raïa Mutomboki du chef milicien Alexandre a pris le contrôle de la localité de Penekusu dans le territoire de Shabunda.
"Avant d'attaquer Penekusu, ce groupe avait d'abord occupé le village de Kikamba où il a arraché deux armes aux policiers qu'il a trouvés sur place. Ces hommes ont pris aussi le contrôle de Nyalukungu où ils ont également arraché des armes aux policiers présents dans ce village", affirme une source onusienne. F
Source: Agence de presse Xinhua
Carte géographique du Lac Rweru
L'affaire fait la Une des journaux burundais depuis deux jours : des pêcheurs affirment avoir vu des dizaines de corps flotter sur le lac Rweru, au nord-est du Burundi, à la frontière avec le Rwanda. Ce sont des corps d'hommes de femmes et de jeunes, pour certains ligotés.
Des pêcheurs du lac Rweru affirment qu’ils auraient vu depuis début juillet entre six et quarante corps flottant sur les eaux de ce lac, situé dans le nord-est du Burundi. Selon plusieurs stations privées de Bujumbura, cette alerte n’a été donnée il y a une semaine.
Joint par RFI hier dimanche, le représentant des pêcheurs de la commune Giteranyi riveraine de ce lac, explique qu’il s’est rendu près de l’embouchure de la rivière Kagera en compagnie des militaires de la Marine burundaise. Ils ont alors découverts sur place deux corps, dont l’un encore enveloppé dans un gros sac de jute. « Nous ne pouvions malheureusement pas les ramener sur la terre ferme car ces corps étaient en état de décomposition avancée », explique le représentant des pêcheurs. Ils ont alors laissé dériver les corps au gré du courant tout comme les autres pêcheurs ont fait avec les corps qu’ils avaient découverts auparavant.
Les précédents du début des années 2010
Depuis l’affaire fait grand bruit au Burundi où chacun garde en mémoire les dizaines d’opposants tués dont les corps avaient été retrouvés dans la rivière Ruvubu dans l’est, et dans la rivière Rusizi dans l’ouest du pays, il y a à peine quelques années.
Mais cette fois, la gouverneure de Muyinga, Manirabarusha Carine, a juré à RFI que ces victimes n’étaient pas des ressortissants de sa province. Les pêcheurs, eux, affirment que ces corps seraient charriés par la rivière Kagera qui prend sa source dans le Rwanda voisin. Prudente, l’administration burundaise n’a pas voulu confirmer ou infirmer.
Byanditswe n'Inyenyeri
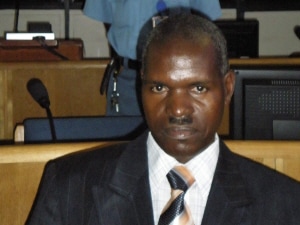 Photo: Capitaine Nizeyimana
Photo: Capitaine Nizeyimana
Arusha, 26 août 2014 (FH) - Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), qui est en train de traiter ses dernières affaires, rendra ses jugements d'appel le 29 septembre dans les procès séparés du capitaine Ildephonse Nizeyimana et de l'ancien ministre Callixte Nzabonimana, tous deux condamnés à la prison à vie en première instance.
L'avant-midi, ce sera le tour de l'officier d'être fixé sur son sort tandis que l'ancien ministre entendra le jugement après-midi, annonce le TPIR sur son site internet.
Au moment du génocide des Tutsis de 1994, le capitaine Nizeyimana, était chargé des renseignements et des opérations à l'Ecole des sous-officiers (ESO) de Butare, dans le sud du Rwanda.
Le 19 juin 2012, il a été condamné à la prison à vie après avoir été reconnu coupable de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, pour de nombreux meurtres perpétrés essentiellement en avril 1994 à Butare et ses environs.
Les juges de première instance ont conclu à sa responsabilité pénale notamment pour avoir autorisé ou ordonné plusieurs meurtres dans la ville de Butare (sud), dont celui de Rosalie Gicanda, veuve de l'avant-dernier roi du Rwanda, Charles-Léon-Pierre Mutara III Rudahigwa.
La reine Rosalie Gicanda était une parente de l'actuel président Paul Kagame.
Participation à une célèbre réunion
Lors de son procès en appel, le 28 avril dernier, l'ancien officier a une nouvelle fois clamé son innocence dans une déclaration où il a soigneusement évité le terme «génocide », préférant parler de « folie indescriptible ».
Fils du nord comme le président Juvénal Habyarimana dont l'assassinat dans la soirée du 6 avril 1994 avait déclenché le génocide, Nizeyimana s'est déclaré « victime d'une campagne de diabolisation orchestrée par le nouveau régime du vainqueur ».
 Photo : Callixte Nzabonimana
Photo : Callixte Nzabonimana
Jugé dans une autre affaire, l'ancien ministre de la Jeunesse Callixe Nzabonimana a été également condamné à la peine maximale au premier degré.
Le 31 mai 2012, l'ancien dignitaire a été jugé coupable génocide, entente en vue de commettre le génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et extermination. Il a été condamné notamment pour sa participation, en compagnie d'autres membres du gouvernement, à une célèbre réunion tenue le 18 avril 1994, à Murambi, dans sa préfecture natale, Gitarama (centre).
Selon le jugement, cette réunion a scellé « un accord » entre Nzabonimana et d'autres ministres, pour « encourager les meurtres de Tutsis ». Les parties à cet accord étaient animées, selon la chambre de première instance, de « l'intention spécifique de détruire en tout ou en partie la population tutsie comme telle, dans la préfecture de Gitarama ».
La seule femme à avoir été inculpée par le TPIR
Plaidant sa cause en appel le 29 avril dernier, l'ex-ministre a qualifié « d'absurdes » les conclusions des premiers juges et a prié la chambre d'appel d'ordonner son acquittement.
Les affaires Nizeyimana et Nzabonimana font partie des dernières du TPIR qui doit théoriquement fermer ses portes d'ici à la fin de l'année, selon un échéancier fixé par les Nations unies.
Selon les prévisions du Tribunal, les anciens président et vice-président du Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement (MRND), Matthieu Ngirumpatse et Edouard Karemera, devraient également être fixés sur le sort avant la fin de l'année. Condamnés à la perpétuité, essentiellement pour des crimes commis par des membres de l'aile jeunesse de leur parti, ils ont soutenu, lors du procès en appel en février dernier, qu'ils n'étaient pas investis de pouvoir judiciaire, militaire ou policier.
En revanche, le procès-phare dans lequel comparaît la seule femme à avoir été inculpée par le TPIR ne sera pas terminé avant la mi-juillet 2015, toujours selon le TPIR. Jugée avec son fils Arsène Shalom Ntahobali, et quatre autres personnalités, l'ancienne ministre de la Famille et de la promotion féminine, Pauline Nyiramasuhuko, a été condamnée à la prison à vie le 24 juin 2011.
La procédure d'appel a été ralentie par des problèmes de traduction du très volumineux jugement. La date de l'audience d'appel n'a pas encore été fixée.
Reste l'ancien ministre du Plan Augustin Ngirabatware, dont l'appel est pendant devant le Mécanisme des Nations unies pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI).
ER
© Agence Hirondelle
Autre article
Ce commentaire nous a été envoyé par CESAR, fidèle lecteur de TFR. Nous le reproduisons in extenso.

"Ce colloque organisé par le TPIR est une mise en scène déplorable voire pitoyable. Il est vrai que les juges de ce tribunal sont des experts en folklores.
1- Le TPIR a été crée par le Conseil de Sécurité de l'ONU uniquement pour rechercher et juger les présumés auteurs des crimes qui ont été commis au Rwanda entre le 01/01 et le 31/12/1994, le tout indistinctement de leur appartenance ethnique, de leurs fonctions et de leurs positions professionnelles, politiques et sociales. La résolution 955 du Conseil de Sécurité est limpide sur ce point.
2- Résultats
- Le TPIR a recherché et jugé les présumés auteurs des crimes qui ont été commis dans notre pays exclusivement sur la base de leur appartenance ethnique en l'espèce l'appartenance à l'ethnie Hutu.Pour les juges de ce tribunal ( qui est une fiction), seuls les Hutu sont responsables des crimes qui ont été commis au Rwanda.
- Pour étayer les accusations, après l'echec cuisant du procureur quant à la production des preuves de la planification du génocide des Rwandais et nullement des Tutsi, les juges du TPIR ont inventé sans vergogne un mot: "génocide des Tutsi." Pour eux il fallait dire et écrire" génocide des Tutsi" par les Hutu et a contrario, il ne fallait pas dire et écrire, "génocide des Hutu" et/ou "génocide des Rwandais." Selon ces juges, aucun crime n'a été commis contre les Hutu et même s'il y en a eu, il ne relève pas de son champ de compétences.Il s'agit donc de crimes de droit commun.Il s'ensuit que le TPIR a fait dire à cette résolution ce qu'elle ne dit pas et a conséquement violé impunément violé son propres statut dans l'indifférence absolue des prédicateurs du respect des droits de l'homme et autres soi-disant experts de l'Affaire Rwandaise. Pour les juges du TPIR, les Tutsi ont été tués par les Hutu parce qu'ils étaient Tutsi et les Hutu ont été exterminés par les soldats tutsi du FPR parce qu'ils le méritaient et non pas parce qu'ils étaient Hutu. Ils ont pour mission de rendre justice dans l'intérêt des seules victimes Tutsi.
- Aux abois, ce tribunal a demandé à Kagame de faire le travail à sa place c'est-à-dire lui fournir la liste des Hutu génocidaires des Tutsi et les accusations à leur endroit et nullement les présumés car c'est leur appartenance ethnique qui est l'élément fondamental dans la commission de ce génocide. Ce que le commandant suprême a fait. Les Hutu ont été condamnés et/ou détenus sur la base des accusations du Rwanda et non du TPIR. L'Affaie du feu Barayagwiza Jean-Bosco est la parfaite illustration. Il a été acquitté deux fois par les juges. Aux abois, la procureure Carla Del Ponte est allé demandé à Kagame de lui donner de nouveaux éléments contre l'accusé.Le service spécial chargé de fabriquer des faits criminels contre les Hutu s'est mis au travail. Dans moins d'une semaine, il a trouvé les faits nouveaux là où les enquêteurs du TPIR n'ont rien trouvé pendant plus de huit ans. Les juges, différents de ceux qui les avaient acquitté, l'ont condamné à plus de trente ans ferme. Jean-Bosco Barayagwiza a fait la grève de la faim pour implorer les juges du TPIR à le faire soigner dans un pays qui a des moyens. Il a produit des justificatifs délivrés par son médecin traitant. Pour les juges du TPIR, il avait été condamné pour mourrir en prison et nullement pour sortir vivant.Il est mort en prison par manque de soins au Bénin.
- Certains juges du TPIR étaient de véritables juges.Ils avaient pour mission de rendre justice et nullement de condamner les accusés parce qu'ils étaient exclusivement Hutu. C'est ainsi que grâce à eux, certains Hutu tels que Monsieur Z, Ndindiliyimana, Mugenzi et autres ont été acquittés.
- Le procureur du TPIR a été incapable d'apporter la preuve du bien-fondé de ses allégations contre Bagosora: la planification et l'exécution du génocide contre les Tutsi par celui-ci, l'existence du génocide des seuls Tutsi. Ces juges ont finalement reconnu que les allégations du procureur sont fondées sur des considérations politiques et nullement juridiques et doivent conséquemment être rejetées. Mais, ce qui est surprenant, en raison des pressions exercées sur eux par le Rwanda et son sponsor principa en l'espèce les USA et pour montrer que le TPIR fait son travail à savoir rendre Justice et uniquement rendre Justice, par le jeu de bricolage juridique ils ont condamné Bagosora à vie.Ils ont reconnu qu'il n'a commis aucun crime contre les Tutsi. C'est donc uniquement en raison de son appartenance ethnique ou le fait d'être Hutu qu'il a été condamné. Même un quasi-analphabète comprend aisément que, alors que le procureur a été incapabled d'apporter la preuve du bien-fondé de ses allégations contre Bagosora: la planification et l'exécution du génocide des Tutsi par l'accusé, l'existence du génocide des seuls Tutsi et que ces juges ont finalement reconnu que les allégations du procureur sont fondées sur des considérations politiques et nullement juridiques et doivent par conséquent être rejetées, la décision du TPIR est fondée sur les seules considérations politiques. Ce qui est gravissime dans cette Affaire c'est que non seulement les juges du TPIR ont méconnu leurs missions à savoir rendre équitablement Justice mais également ils ont inventé des faits contre l'accusé. Alors qu'ils ont reconnu que Baogosora était directeur de Cabinet du Ministre de la défense et retraité de l'armée rwandaise, ils ont sans vergogne écrit dans leur décision que Bagosora avait une autorité et un pouvoir de commandement sur les FAR d'une part et des bataillons sous ses ordres d'autre part. Pour ce motif, ils l'ont condamné pour de les crimes qualifiés de génocide commis contre les Tutsi par les soldats fantômes qui étaient sous ses prétendus ordres. La décision des Juges du TPIR dans cette affaire est inique mais elle n'est pas la seule. Aucun homme doué de rationnalité élémentaire ne peut comprendre comment un retraité de l'armée rwandaise (différente des FAR) et directeur de cabinet d'un ministère soit-il celui de la défense dont les missions étaient précisées par les lois de la République Rwandaise avait des bataillons de la gendarmie rwandaise et de l'armée rwandaise inconnus des Rwandais sous son commandement. Il ne peut non plus comprendre comment les juges du TPIR ont acquitté à bon droit, le chef d'Etat major de la Gendarmerie Rwandaise et le commandant du bataillon de reconnaissance aux seuls motifs qu'au-delà de tout doute raisonnable, ils ne sont nullement responsables des crimes qui ont été commis contre les Tutsi par les soldats qui étaient directement sous leurs ordres et condamné un retraité et directeur de cabinet d'un ministère et le commandant du bataillon para-commando pour les crimes commis contre les mêmes Tutsi par les soi-disant soldats qui étaient sous leurs ordres, le tout en l'absence de preuve quant aux ordres directs ou indirects donnés par les accusés à ces soldats pour exterminer les Tutsi. Un expert du TPIR peut éclairer les lecteurs de la Trbune franco-rwandaise sur la logique juridique des juges du TPIR.
Ntabakuze Aloys était effectivement commandant du bataillon para-commando et avait conséquemment des officiers, sous officiers et soldats simples sous ses ordres. Nzuwonemeye était effectivement commandant du bataillon de reconnaissance et avait des officiers, sous-officiers et soldats simples sous ses ordres.
Major Ntabakuze a été condamné à perpétuité pour les crimes commis par les soldats qui étaient sous ses odres, le tout en l'absence d'un ordre direct ou indirect qu'il aurait donné à ces soldats pour génocider les Tutsi. Parce qu'il en était au courant et n'a rien fait pour y mettre fin notamment il n'a pas sanctionné c'est-à-dire il n'a pas fait juger par la cour militaires des auteurs de ces crimes selon les juges. Aucun autre officier para-commando n'a été arrêté, jugé et condamné pour les crimes commis par les soldats qui étaient sous ses ordres
Nzuwonemeye a été à bon droit acquitté des crimes qui ont été commis par les soldats qui étaient sous ses ordres aux motifs qu'au regard de la situation d'ensemble à l'époque des faits et des circonstances au Rwanda, au-delà de tout doute raisonnable, même s'il en était au courant, il ne pouvait pas sanctionner les auteurs de ces crimes ou y mettre fin et surtout, en raison de l'effondrement des institutions rwandaises dont la Cour militaire.
Il en a été de même concernant le chef d'Etat-major de la gendarmerie nationale Général Ndindiliyimana, seul gendarme qui a été arrêté, jugé et acquitté par le TPIR. Les juges ont ajouté que même s'il est Hutu, il était au surplus modéré par opposition aux extrémistes Hutu tels que Bagosora, Ntabakuze et autres condamnés.
Au vu de l'ensemble des travaux du TPIR, celui-ci a fait et fait la politique. Il est dépourvu de toute qualité de juridiction.Il est au service du régime tutsi rwandais et des sponsors de celui-ci. Par ses décisions iniques, il s'est lui-même discrédité. Par conséquent, il n'a apporté et n'apportera aucune contribution au développement du droit international humanitaire, l'administration de la justice et la promotion de la primauté du droit. A son actif, il ya la primauté de la politique et conséquemment de l'injustice.Que celui qui connaît una affaire où il a rendu une décison juste et équitable la cite et explique pourquoi et comment. N'a-t-il pas condamné une personne à savoir Docteur Mathieu Ngirumpatse qui ne peut même pas tuer un chat."
http://www.france-rwanda.info/2014/08/tpir-conference-un-colloque-debut-novembre-sur-l-heritage-du-tpir.html